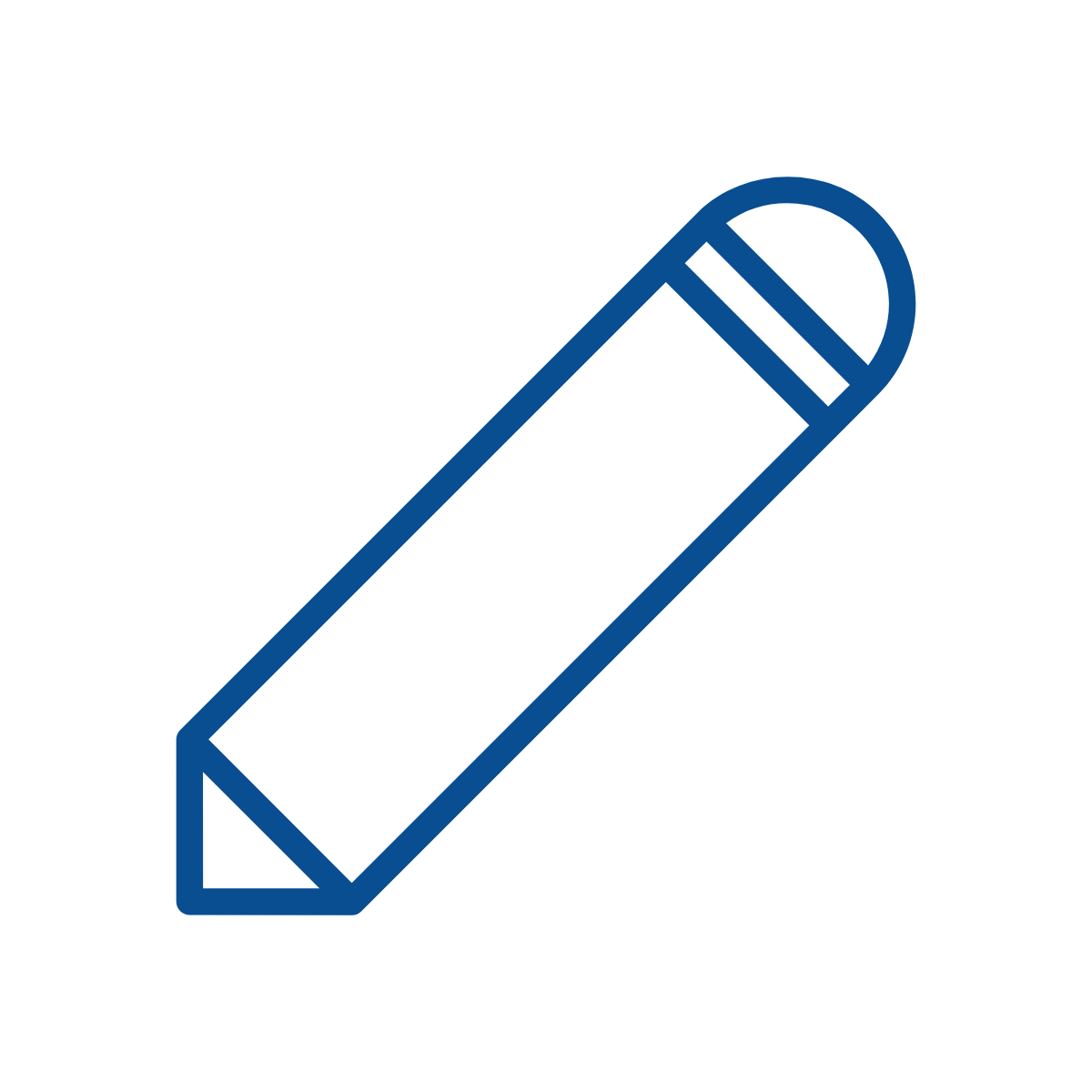Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Bien-être psychologique et conditions de vie pendant la pandémie de COVID-19 à Bruxelles
Publié le 21 novembre 2025
– Mis à jour le 21 novembre 2025
Cinq ans après le premier confinement lié au Covid-19, les séquelles psychologiques et sociales de la pandémie persistent, notamment à Bruxelles, où les inégalités se sont creusées. Une étude menée par Camila Arnal, Chiara Inserra, Christophe Leys, Olivier Klein (psychologie, ULB) et Olivier Gennart (architecture) révèle les résultats d'une enquête sur les relations entre les conditions de vie et le bien-être psychologique des Bruxellois et Bruxelloises après deux mois de confinement.
L'article a été publié par Brussels Studies. Auteurs : Camila Arnal, Olivier Gennart, Chiara Inserra, Christophe Leys et Olivier Klein
Cinq ans et demi après l’instauration du premier confinement lié au Covid-19 en Belgique, le « monde d’après » n’est pas celui apaisé, centré sur des valeurs renouvelées et plus juste dont certains rêvaient. Au contraire, les inégalités économiques se sont accentuées. Plus nombreux sont ceux qui expriment aussi une souffrance psychologique, en particulier chez les jeunes et les enfants. Si les confinements successifs et leurs conséquences sur les rapports sociaux figurent sans doute parmi les raisons de ce malaise, on peut légitimement se questionner sur les facteurs spécifiques qui ont influencé le vécu de la pandémie dans une ville aussi diverse que Bruxelles. Dans le nouveau numéro de Brussels Studies, des chercheuses et chercheurs en psychologie de l’Université libre de Bruxelles (Camila Arnal, Chiara Inserra, Christophe Leys, Olivier Klein) et en architecture (Olivier Gennart) nous ramènent aux premiers mois de la pandémie.
Leur étude interroge les relations entre les conditions de vie et le bien-être psychologique des Bruxellois et Bruxelloises après deux mois de confinement. Les données ont été collectées en mai 2020 par le biais d’une enquête en ligne diffusée sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille. Quelque 315 personnes y ont participé et ont répondu à des questions portant sur leur logement, leur pratique d’activités extérieures, l’importance attachée à la présence d’espaces verts dans leur environnement, leur état psychologique (états émotionnels positifs et négatifs), leur âge et leur quartier de résidence.
Les résultats confirment que la pratique d’une activité physique et l’âge constituent des variables prédictives significatives du bien-être. L’importance attachée aux espaces verts et en particulier aux jardins privés a été également renforcée durant le premier confinement. Pour les autrices et auteurs, cela souligne la nécessité de mettre en place des politiques urbaines qui favorisent un accès équitable aux espaces verts dont les bienfaits ne se limitent pas aux loisirs et ont une incidence directe sur le bien-être. Étant donné la répartition inégale de ces espaces en Région bruxelloise, il est possible que les habitants des communes les moins riches aient été confrontés à des obstacles plus importants pour pratiquer des activités de plein air, ce qui a encore accentué les disparités socioéconomiques en matière de bien-être.
Enfin, il ressort des résultats que ce sont les jeunes qui ont particulièrement souffert psychologiquement des conditions imposées par le confinement (anxiété et dépression plus élevées pour les jeunes, sentiment de bonheur croissant avec l’âge). Ce phénomène est particulièrement marqué à Bruxelles, où bon nombre des quartiers les plus pauvres, aux conditions de vie moins favorables, sont également ceux dont la composition démographique est la plus jeune. La jeunesse y donc est confrontée à des facteurs de stress supplémentaires, tels que des logements inadéquats, un accès limité aux espaces verts et des taux de chômage élevés, qui peuvent exacerber les sentiments d’anxiété et d’exclusion sociale. Il est essentiel de diminuer ces disparités mais aussi de renforcer les dispositifs de santé mentale consacrés aux jeunes, non pas tant pour gérer d’éventuelles nouvelles crises que pour favoriser la santé mentale et la cohésion sociale sur le long terme.
Consulter l'article
Cinq ans et demi après l’instauration du premier confinement lié au Covid-19 en Belgique, le « monde d’après » n’est pas celui apaisé, centré sur des valeurs renouvelées et plus juste dont certains rêvaient. Au contraire, les inégalités économiques se sont accentuées. Plus nombreux sont ceux qui expriment aussi une souffrance psychologique, en particulier chez les jeunes et les enfants. Si les confinements successifs et leurs conséquences sur les rapports sociaux figurent sans doute parmi les raisons de ce malaise, on peut légitimement se questionner sur les facteurs spécifiques qui ont influencé le vécu de la pandémie dans une ville aussi diverse que Bruxelles. Dans le nouveau numéro de Brussels Studies, des chercheuses et chercheurs en psychologie de l’Université libre de Bruxelles (Camila Arnal, Chiara Inserra, Christophe Leys, Olivier Klein) et en architecture (Olivier Gennart) nous ramènent aux premiers mois de la pandémie.
Leur étude interroge les relations entre les conditions de vie et le bien-être psychologique des Bruxellois et Bruxelloises après deux mois de confinement. Les données ont été collectées en mai 2020 par le biais d’une enquête en ligne diffusée sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille. Quelque 315 personnes y ont participé et ont répondu à des questions portant sur leur logement, leur pratique d’activités extérieures, l’importance attachée à la présence d’espaces verts dans leur environnement, leur état psychologique (états émotionnels positifs et négatifs), leur âge et leur quartier de résidence.
Les résultats confirment que la pratique d’une activité physique et l’âge constituent des variables prédictives significatives du bien-être. L’importance attachée aux espaces verts et en particulier aux jardins privés a été également renforcée durant le premier confinement. Pour les autrices et auteurs, cela souligne la nécessité de mettre en place des politiques urbaines qui favorisent un accès équitable aux espaces verts dont les bienfaits ne se limitent pas aux loisirs et ont une incidence directe sur le bien-être. Étant donné la répartition inégale de ces espaces en Région bruxelloise, il est possible que les habitants des communes les moins riches aient été confrontés à des obstacles plus importants pour pratiquer des activités de plein air, ce qui a encore accentué les disparités socioéconomiques en matière de bien-être.
Enfin, il ressort des résultats que ce sont les jeunes qui ont particulièrement souffert psychologiquement des conditions imposées par le confinement (anxiété et dépression plus élevées pour les jeunes, sentiment de bonheur croissant avec l’âge). Ce phénomène est particulièrement marqué à Bruxelles, où bon nombre des quartiers les plus pauvres, aux conditions de vie moins favorables, sont également ceux dont la composition démographique est la plus jeune. La jeunesse y donc est confrontée à des facteurs de stress supplémentaires, tels que des logements inadéquats, un accès limité aux espaces verts et des taux de chômage élevés, qui peuvent exacerber les sentiments d’anxiété et d’exclusion sociale. Il est essentiel de diminuer ces disparités mais aussi de renforcer les dispositifs de santé mentale consacrés aux jeunes, non pas tant pour gérer d’éventuelles nouvelles crises que pour favoriser la santé mentale et la cohésion sociale sur le long terme.
Consulter l'article