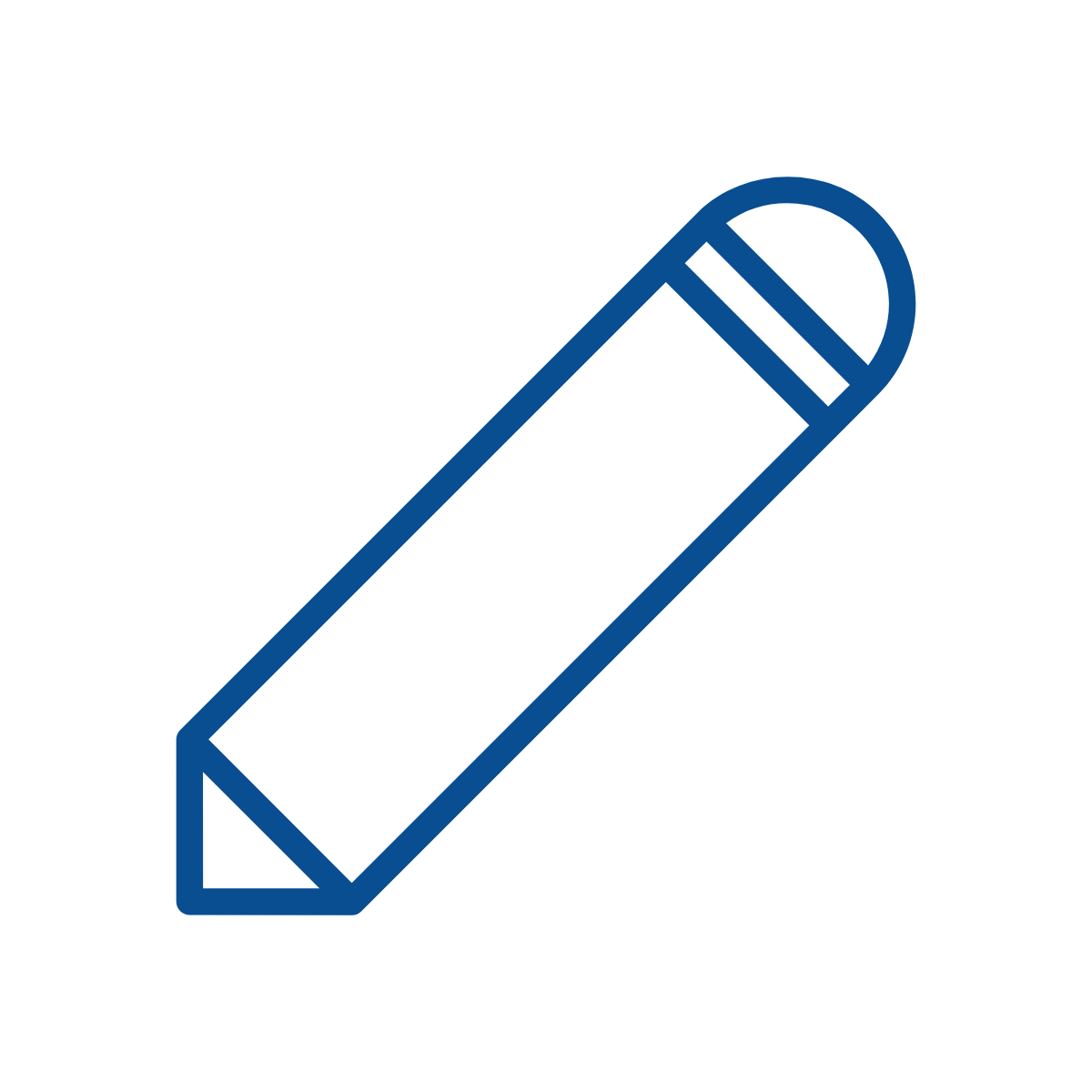Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Sur les traces de Michel Ecochard – une collaboration CIVIS autour de l'urbanisme moderne
Du 14 au 18 avril, l’Université Hassan II de Casablanca a accueilli un workshop interdisciplinaire intitulé « Sur les traces de Michel Ecochard ». Ce projet de recherche, mené en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles (ULB), Aix-Marseille Université et l’Université de Tübingen, toutes membres de l’alliance européenne CIVIS, a rassemblé chercheurs, étudiants et enseignants autour d’une réflexion commune sur l’espace public dans les quartiers conçus selon les principes de l’urbaniste Michel Ecochard.
Une collaboration CIVIS autour de l’urbanisme moderne
Le workshop s’est tenu dans le quartier d’Aïn Chock, à Casablanca, un territoire emblématique de l’urbanisme moderniste construit sous protectorat français. L’Université libre de Bruxelles était représentée par Victor Brunfaut et Judith Le Maire, enseignants à la Faculté d’architecture La Cambre Horta. En tout, 19 participants dont des étudiants en bachelier et master, doctorants et chercheurs, ont pris part à cette semaine, accompagnés par des enseignants-chercheurs Fadma Ait Mous de l'Université Hassan II de Casablanca, Claire Bullen de l'Université de Tübingen, Muriel Girard et Amel Zerourou de Aix-Marseille.
L’objectif principal du projet était explorer les usages et aménagements de l’espace public à travers des méthodes issues à la fois de l’architecture et des sciences sociales. À l’intersection de ces disciplines, les participants ont partagé outils, approches et pratiques pour mieux comprendre la fabrique urbaine et les dynamiques sociales qui la traversent.
Entretien avec le professeur Victor Brunfaut
Quels étaient les objectifs principaux du projet ?
Le workshop était l’occasion pour les enseignant.e.s et chercheur.e.s des universités et écoles partenaires d’échanger sur les questions spécifiques posées. Il ne s’agissait pas de résoudre des problèmes architecturaux, mais d’identifier des questions pertinentes à partir de l’analyse du terrain : relevés, arpentages, observations des temporalités, entretiens, récits, story-boards (voir par exemple Nicolas Nova, Exercices d’observation, Paris 2022). Il ne s’agissait donc pas d’un travail de projet au sens où l’entendent les architectes : on ne cherche pas à « résoudre des problèmes », ou à donner des solutions à des questions, mais plutôt identifier les questions et pistes de réflexion à partir du relevé de situations, de dispositifs spatiaux.
Quelle est la particularité du terrain d’étude sélectionné à Casablanca ?
Ce quartier, situé au sud-est de Casablanca, constitue un exemple emblématique de l’urbanisme moderne mis en place sous le protectorat français. Conçu dans les années 1930 selon les principes de la Charte d’Athènes (l’habitation, le travail, la circulation, et la culture physique et spirituelle), ce quartier reflète une vision progressiste articulée autour des besoins fonctionnels et sociaux des habitants.
Construit autour d’un noyau dessiné par Marchisio dans les années 1940 qui constitue une tentative de rationalisation des expériences de type « Habous » proposées auparavant par le Protectorat, le quartier s’est développé en appliquant la trame Ecochard, sous la houlette du Service de l’urbanisme, tant à la fin du Protectorat qu’après. Aïn Chock a été pensé comme un modèle de rationalité spatiale.
Le quartier dispose d’infrastructures qui incarnent cette conception fonctionnelle : un msalla pour les rassemblements, la Dar Cadi Ben Dris comme bâtiment administratif, un bureau de poste, la maison des enfants pour l’éducation et la culture, et la radio nationale, symbole de modernité. Ces équipements ont permis d’ancrer une vie communautaire structurée.
Marqué par une identité forte, Aïn Chock incarne la tension entre une urbanisation rationalisée et la valorisation des particularismes culturels locaux. Cette dualité se retrouve dans ses formes architecturales, ses usages des espaces publics et ses dynamiques sociales. Cependant, le quartier fait face à des défis contemporains : la densité croissante, la pression sur les espaces publics, la nécessité de préserver un patrimoine architectural singulier, et l’enjeu d’une intégration harmonieuse des nouveaux développements. Aïn Chock demeure ainsi un territoire en transformation, où se rejoue l’équilibre entre modernité urbaine et héritage historique.
Qu’ont retiré les participants de cette expérience ?
Le principal enseignement pour les étudiant.e.s et doctorant.e.s, principalement sociologues, a été constitué par la confrontation avec des questions relevant des disciplines de l’espace (architecture et urbanisme). Le travail par trinômes mélangeant les niveaux (étudiant.e.s et doctorant.e.s) et les profils (sociologie, anthropologie, architecture) a permis de soulever de nouvelles questions et manières de voir.
Quels bénéfices et perspectives pour la suite ?
Les principaux bénéfices ont trait au partage de méthodes et d’approches, au sein d’une même discipline ou entre disciplines, mais la collaboration permet aussi de réfléchir aux différences dans l’organisation de l’enseignement et de la recherche entre institutions. Le travail en commun permet d’apprendre à connaître les travaux développés par d’autres institutions, et de réfléchir à des projets de collaboration futurs. Pour les doctorant.e.s, le contact avec des chercheur.e.s d’autres institutions permet d’enrichir les connaissances et de consolider, valider, nuancer les axes de recherche. Cela permet aussi de prendre connaissance ou de développer des réseaux de recherche..
Des pistes de collaboration futures autour de la question des espaces publics dans la perspective d’un croisement interdisciplinaire entre sociologie et architecture ont été abordées, dont notamment un travail possible sur l’espace public dans les villes méditerranéennes (Marseille, Casablanca) ou encore un travail autour de l’action de Michel Ecochard à Dakar (..).

Cette rencontre a bénéficié d’un financement seed funding de l’alliance CIVIS.
Pour toute question sur les opportunités et financements au sein de l’alliance, veuillez contacter Marie Ugeux (marie.ugeux@ulb.be).