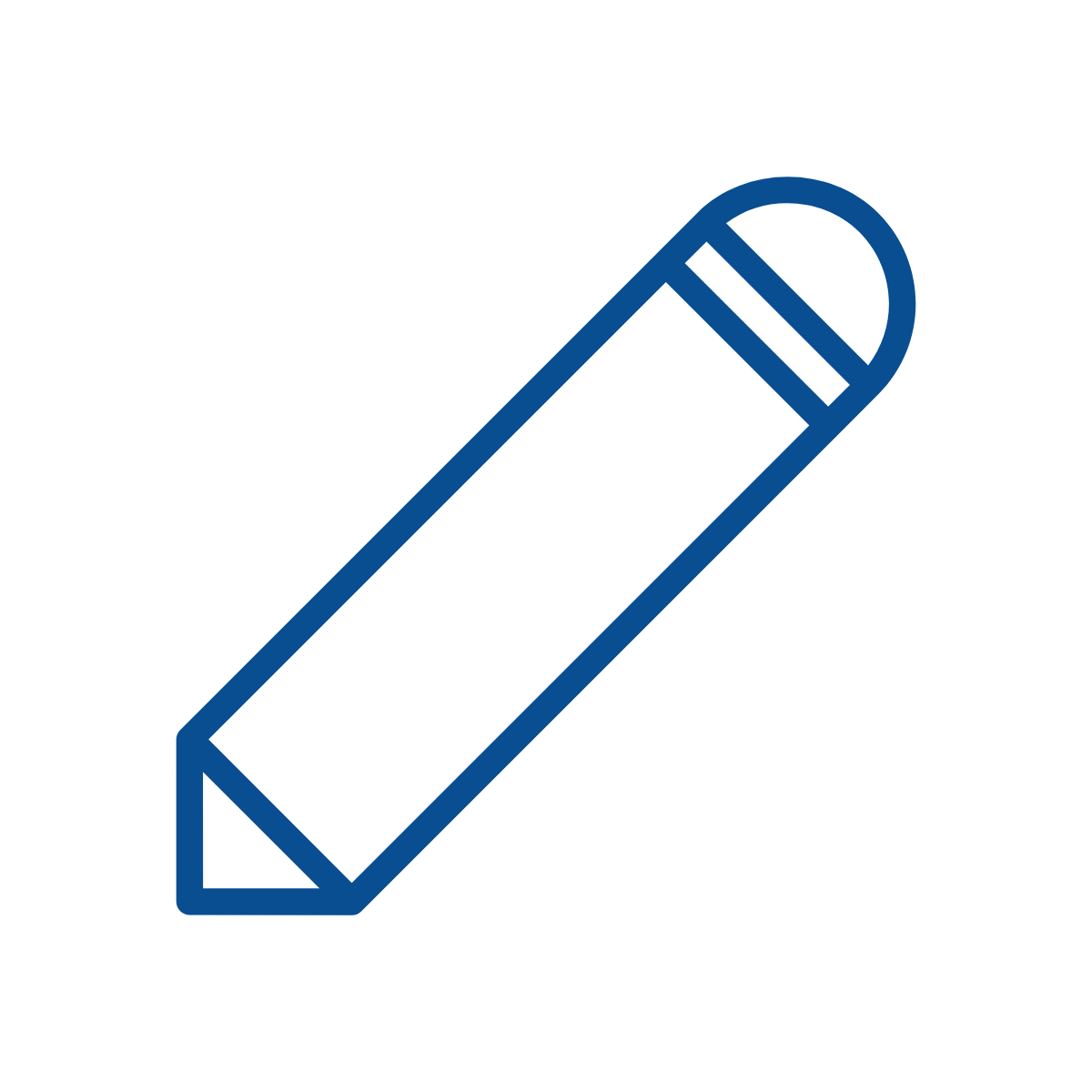« Libérés de leurs fonctions » : c’est ainsi que les contributeurs du rapport de la Sixième évaluation nationale du climat (NCA6) ont été « remerciés » par Donald Trump le 28 avril. Ce dernier invoque la nécessité de « réévaluer » la « portée » de ce rapport qui est utilisé comme référence depuis 25 ans par le législateur américain.
Cette décision s’inscrit dans le sillage de nombreuses autres, qui visent à démanteler les institutions scientifiques qui étudient les questions climatiques et à abolir toutes les régulations susceptibles d’entraver les activités économiques. Citons la sortie de l’accord de Paris (qui vise à limiter l’élévation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C, idéalement à 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels) ; la signature d’un décret destiné à permettre l’extraction à grande échelle de minerais dans les grands fonds océaniques, y compris en eaux internationales ; des mesures visant à augmenter l’exploitation des énergies fossiles et à annuler l’interdiction, édictée par Joe Biden, sur le forage en mer ; ainsi que l’arrêt de nombreux programmes d’énergie propre conduits par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).
Cette politique pourrait être considérée comme la simple continuation du climatoscepticisme affiché par Trump lors de son premier mandat. Mais plusieurs experts affirment que ce deuxième mandat de Trump est beaucoup mieux préparé que le premier et repose sur un socle idéologique cohérent. Il est donc nécessaire de s’interroger sur ses objectifs réels et leurs conséquences pour l’Europe.
Les accords de Paris sont aujourd’hui intenables
En 2023, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avait souligné l’absolue nécessité de réduire les émissions de CO2 dès 2025 et d’aboutir en 2050 à des émissions nettes négatives pour limiter le réchauffement climatique à +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Ceci afin d’éviter de franchir des points de bascule pouvant entraîner irréversiblement notre système climatique sur une trajectoire dite de « Hothouse Earth » (terre étuve).
Mais dès 2023, une évaluation du Carbon Global Project jugeait déjà cet objectif de +1,5° inatteignable. En 2024, une autre étude avait conclu à une sous-estimation de la vitesse du dérèglement climatique et à une accélération de celui-ci. Avec raison, car l’année 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne mondiale d’environ 1,55 °C plus élevée que le niveau préindustriel.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Ce constat alarmant a mené plusieurs personnalités bien informées, comme Éric Schmidt, l’ex-PDG de Google, à conclure en 2024 que « nous n’atteindrons pas les objectifs climatiques parce que nous ne sommes pas organisés pour le faire ». Un message repris en 2025 par le Tony Blair Institute for Global Change, qui conclut que « toute stratégie basée soit sur l’élimination progressive des combustibles fossiles à court terme, soit sur la limitation de la consommation est une stratégie vouée à l’échec ». En effet, force est de constater que si l’ensemble des engagements climatiques nationaux étaient intégralement mis en œuvre avec succès et dans les temps, la hausse des températures moyennes mondiales atteindrait quand même les +2 °C.
Le franchissement des points de bascule semble donc à la fois proche et inéluctable, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Plusieurs régions densément peuplées, comme l’Inde, l’Afrique de l’Ouest et le bassin amazonien, mais aussi les États-Unis, pourraient connaître des sécheresses extrêmes et des pics de température dépassant les capacités de thermorégulation humaine. Ainsi, dans les 50 prochaines années, un tiers de la population mondiale pourrait sortir de la niche climatique, comprise entre 11 et 15 degrés, favorable aux activités humaines, notamment en termes de PIB, comme le montre l’étude de Burke et ses collègues, ce qui pourrait donner lieu à des migrations de masse.
Des modèles mettent aussi en garde contre un possible effondrement de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (AMOC) suite au réchauffement des océans. L’arrêt de l’AMOC entraînerait un climat plus froid et plus sec en Europe, ce qui réduirait sévèrement sa productivité agricole. Il provoquerait également des sécheresses en Afrique et en Asie.
L’ensemble de ces phénomènes augmenterait les risques de conflits au sein des États ainsi qu’entre les États et pourrait aboutir à un effondrement mondial, un scénario qualifié de « endgame » et qui est pris de plus en plus au sérieux par les scientifiques.
Une stratégie impérialiste d’adaptation à une « Hothouse Earth »
Plutôt que chercher à s’aligner sur des politiques climatiques aux résultats plus qu’incertains, Trump et ses soutiens semblent avoir décidé de tout faire pour assurer le leadership des États-Unis dans un monde à +2 °C.
Or cette tâche est complexe. Du fait de la faiblesse de leurs réserves en minerais critiques nécessaires à la transition énergétique, à la défense et l’armement (tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre) et de leur forte dépendance aux hydrocarbures, les États-Unis risquent de faire partie des grands perdants de la transition énergétique. Dans cette perspective, ils n’ont d’autre choix, pour conserver leur statut de première puissance, que de s’emparer des ressources nécessaires à la transition énergétique et au maintien de leur hégémonie numérique.
Ainsi, on peut relier chacune des récentes déclarations du président Trump à propos du Canada, du Groenland et de l’Ukraine à une volonté de contrôler les ressources qui seront vitales aux États-Unis dans un monde à +2 degrés.
Son projet d’annexer le Canada peut se comprendre à la fois par les réserves d’eau douce dont dispose ce pays, cruciales pour l’industrie des semi-conducteurs et le développement de l’IA, mais également par sa productivité agricole qui pourrait s’accroître avec l’augmentation des températures.
Le Groenland regorge également d’eau douce mais aussi de matières premières critiques et occupe une position stratégique vis-à-vis de la Russie et de la Chine.
Quant à l’Ukraine, elle possède des minerais critiques (lithium, nickel, uranium) nécessaires à la fois au développement de l’IA, mais aussi à la transition énergétique.
Les idéologies MAGA et Dark Enlightenment légitimisent une politique impérialiste
Cette stratégie impérialiste d’adaptation au dérèglement climatique s’inscrit dans la logique de l’idéologie MAGA ainsi que dans celle du Dark Enlightenment.
Le mouvement populiste conservateur MAGA (Make America Great Again), centré sur la personnalité de Trump, promeut la défense des intérêts des États-Unis. Cette défense peut être comprise par ses partisans les plus radicaux comme un appel à réaliser la Manifest Destiny (Destinée manifeste) des États-Unis, c’est-à-dire la croyance selon laquelle ceux-ci ont pour mission divine et historique d’étendre leur hégémonie sur l’ensemble du continent nord-américain.
Ce concept de Manifest Destiny s’inspire de la doctrine Monroe (l’interdiction adressée par le président James Monroe en 1823 à tous les pays du monde de s’ingérer dans les affaires du continent nord-américain). Il s’appuie sur un mélange de messianisme religieux, de nationalisme expansionniste et de suprémacisme blanc. Il a servi de justification à l’annexion du Texas en 1845, à la guerre contre le Mexique (1846–1848), et à l’acquisition de la Californie en 1848.
« The Dark Enlightenment » (Les Lumières sombres) est le titre d’un essai critiquant les principes des Lumières et du progressisme moderne publié en 2012 par le philosophe britannique Nick Land, qui y développe l’idée que la démocratie libérale est une illusion aussi inefficace qu’autodestructrice, et que seule une approche radicale fondée sur la sélection naturelle par la technologie et le capitalisme accéléré pourrait permettre à l’humanité de se dépasser et de survivre aux crises à venir.
Du point de vue du mouvement Dark Enlightenment, aussi qualifié de néoréaction (et abrégé NRx), le dérèglement climatique n’est pas une menace. Il peut même représenter une occasion d’en finir avec la démocratie et l’ordre international. Car le chaos engendré par les pénuries, les migrations et les conflits permettrait aux plus forts de s’imposer.
L’informaticien et blogueur Curtis Yarvin, aujourd’hui connu comme le gourou de la néoréaction, a accédé à la notoriété en popularisant les thèses du Dark Enlightenment. Il a été accueilli comme un prophète par certains oligarques de la tech tels que les cofondateurs de PayPal, David Sacks et Peter Thiel, et le fondateur de Mosaic, Marc Andreessen, mais aussi par des figures clés de la nouvelle administration Trump comme le vice-président J. D. Vance, un protégé de Thiel, et l’entrepreneur Elon Musk, propriétaire de Tesla, SpaceX et du réseau social X. Et pour cause : Yarvin propose de remplacer la démocratie par un gouvernement centralisé dirigé par un CEO (Chief Executive Officer), sur le modèle d’une entreprise privée.
Durant les élections, lors d’un rassemblement de soutien à Trump, Musk, qui arborait une casquette noire avec le slogan MAGA « Make America Great Again », a déclaré « Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seulement MAGA, je suis Dark Gothic MAGA ». Une référence à l’alliance entre l’idéologie conservatrice MAGA et le Dark Enlightenment du mouvement NRx.
La politique de Trump exacerbe la compétition internationale
Ainsi, interpréter sous l’angle du climatoscepticisme ou de l’irrationalité le projet porté par l’administration Trump serait une erreur. Celui-ci comporte indéniablement une dimension pragmatique et est dicté par la volonté d’assurer le leadership des USA dans un monde à +2 °C.
Il est urgent que l’Europe sorte de sa sidération et prenne la mesure du changement de stratégie et d’idéologie de son « allié » américain. Alors que la Commission européenne tente encore de développer des partenariats économiques via des traités comme le Mercosur, les États-Unis de Trump, eux, abandonnent la mondialisation et le libre-échange et visent, quel qu’en soit le prix, leur autonomie en matières premières critiques.
Cette nouvelle politique états-unienne, faite de menaces et de chantage à l’encontre de pays alliés, qui banalise la stratégie du « gros bâton » du président Theodore Roosevelt, place les autres pays dans une situation inconfortable.
Soit ils adoptent une posture attentiste, et le risque est grand pour eux de subir les conséquences de l’accélération du dérèglement climatique généré par la politique américaine tout en étant privés d’une partie des ressources nécessaires à leur adaptation et à la protection de leur population.
Soit ils s’engagent eux aussi dans une politique impérialiste de prédation, fort éloignée de l’impératif de coordination et de coopération qu’impose la lutte contre les menaces globales comme le dérèglement climatique. Dans ce dernier cas, la dynamique compétitive entre les grandes puissances sera exacerbée, à la fois au niveau économique et militaire, ce qui accélérera encore le dépassement des limites planétaires, la dégradation des écosystèmes et les risques pour les générations futures.![]()
Eric Muraille, Biologiste, Immunologiste. Directeur de recherches au FNRS, Université Libre de Bruxelles (ULB) and Philippe Naccache, Professeur Associé, INSEEC Grande École
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.