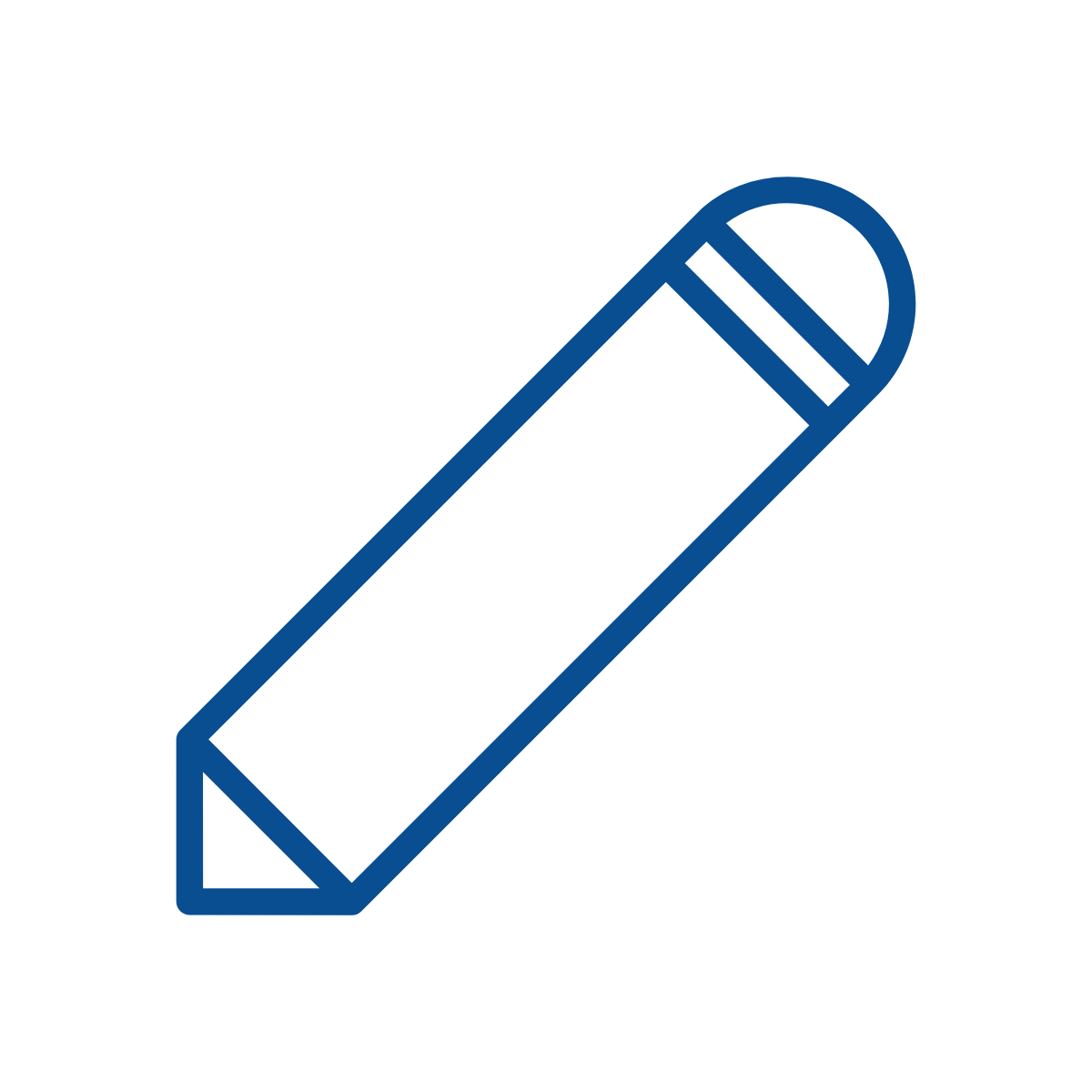Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Un enfant après un cancer? Préserver la fertilité des patient·es
Isabelle Demeestere, directrice du laboratoire de recherche en reproduction humaine à la Faculté de Médecine, se consacre à un défi majeur : permettre aux patients et patientes atteints de cancer de préserver leur fertilité et d’envisager l’avenir sereinement. Le HUB est aujourd’hui un centre de référence dans ce domaine, avec des équipes pluridisciplinaires, composées de médecins, biologistes, coordinatrices et oncologues, œuvrant chaque jour pour offrir les meilleures options afin de préserver la fertilité des jeunes patients et patientes et d’améliorer la qualité de vie.
Après cinq années d’assistanat en gynécologie, Isabelle Demeestere a pris un tournant décisif dans sa carrière en se lançant dans la recherche académique, se concentrant sur un domaine encore peu exploré à l’époque : la préservation de la fertilité.
Un sujet qui lui est particulièrement cher : « J’ai énormément pratiqué la procréation médicalement assistée pendant mon assistanat. Ce projet de préservation m’a été proposé dans le cadre d'un financement "Télévie" qui a permis à trois universités de développer un programme inédit en la matière. On cherchait un médecin pour coordonner ce programme à la clinique d'Erasme, et j’ai été acceptée», raconte-t-elle. Cette discipline, alliant recherche innovante et clinique de terrain, ne l’a plus quittée depuis.
Un laboratoire pluridisciplinaire
Le laboratoire de recherche en reproduction humaine de l’ULB se distingue par son approche pluridisciplinaire. « Nous travaillons véritablement en équipe, avec des médecins, des biologistes, des bioingénieurs et des oncologues. Ce domaine ne peut se concevoir que dans la collaboration, car les données et le nombre de patients sont insuffisants pour une prise en charge isolée », souligne Isabelle Demeestere.
La diversité des compétences permet d’enrichir les recherches et d’offrir des solutions adaptées aux défis complexes que représente la fertilité après un cancer.
Une prise en charge urgente et essentielle
En raison de la nature urgente des situations, la clinique de la fertilité met en place des protocoles rapides : « Les oncologues nous contactent immédiatement », précise Isabelle Demeestere, « ce qui nous permet de prendre en charge les patients et patientes dans les plus brefs délais. Cette réactivité est cruciale, car les émotions sont fortes, et il y a une grande incertitude au moment du diagnostic”, explique la chercheuse.
Le laboratoire et la clinique de la fertilité se spécialisent dans la préservation de la fertilité avant les traitements oncologiques, mais également dans l’accompagnement des patients après leurs traitements, pour les aider à réaliser leurs projets familiaux. « L’objectif principal est de donner aux jeunes patients la possibilité d’avoir des enfants, malgré les traitements susceptibles d'affecter leur fertilité, comme ceux qui touchent les ovaires ou les testicules, mais aussi d’assurer une prise en charge globale du désir de grossesse après le cancer», explique la chercheuse.
Un travail de terrain et de recherche
Au-delà de l’aspect clinique, le laboratoire mène également des recherches fondamentales sur les effets des traitements sur la fertilité. « Nous étudions comment les chimiothérapies et les nouvelles thérapies peuvent affecter la fertilité, en particulier au niveau des ovaires. Il s'agit d’un axe de recherche majeur, car il y a une forte évolution dans les traitements contre le cancer », précise Isabelle Demeestere. Ces recherches ne se limitent pas aux traitements contre le cancer ; elles visent également à mieux comprendre les facteurs qui influencent la fertilité de manière générale.
Un avenir à construire après la guérison
Avec les progrès en oncologie, de plus en plus de patients survivent à leur cancer. Cette évolution pose la question de leur qualité de vie post-cancer. « Aujourd’hui, 80 à 90 % des jeunes patients atteints de cancer survivent, ce qui fait d’eux une part importante de la population. Il est donc essentiel d’assurer une prise en charge adaptée pour leur offrir une qualité de vie optimale », explique Isabelle Demeestere.
Dans cette perspective, plusieurs projets de recherche, en collaboration avec l’École de Santé publique, le Pôle Santé de l’ULB et le HUB, ainsi qu’au niveau européen, sont en cours. « Les problématiques sexuelles et de fertilité ne peuvent être dissociées des enjeux personnels et professionnels, comme le retour au travail ou la gestion de la dépression. Une prise en charge globale et transdisciplinaire est donc primordiale », ajoute-t-elle.
La double casquette de praticienne et de chercheuse confère à Isabelle Demeestere une vision globale et concrète de son travail. « Les premières patientes que nous avons traitées pour la cryopréservation de tissus ovariens il y a vingt ans, reviennent aujourd’hui pour avoir des enfants. Ce n’est pas juste de la recherche, c’est voir des procédures expérimentales devenir des solutions concrètes et remboursées par l’INAMI. C’est là que l’on mesure tout le sens de notre travail », conclut-elle.
Dans la même thématique
Portrait