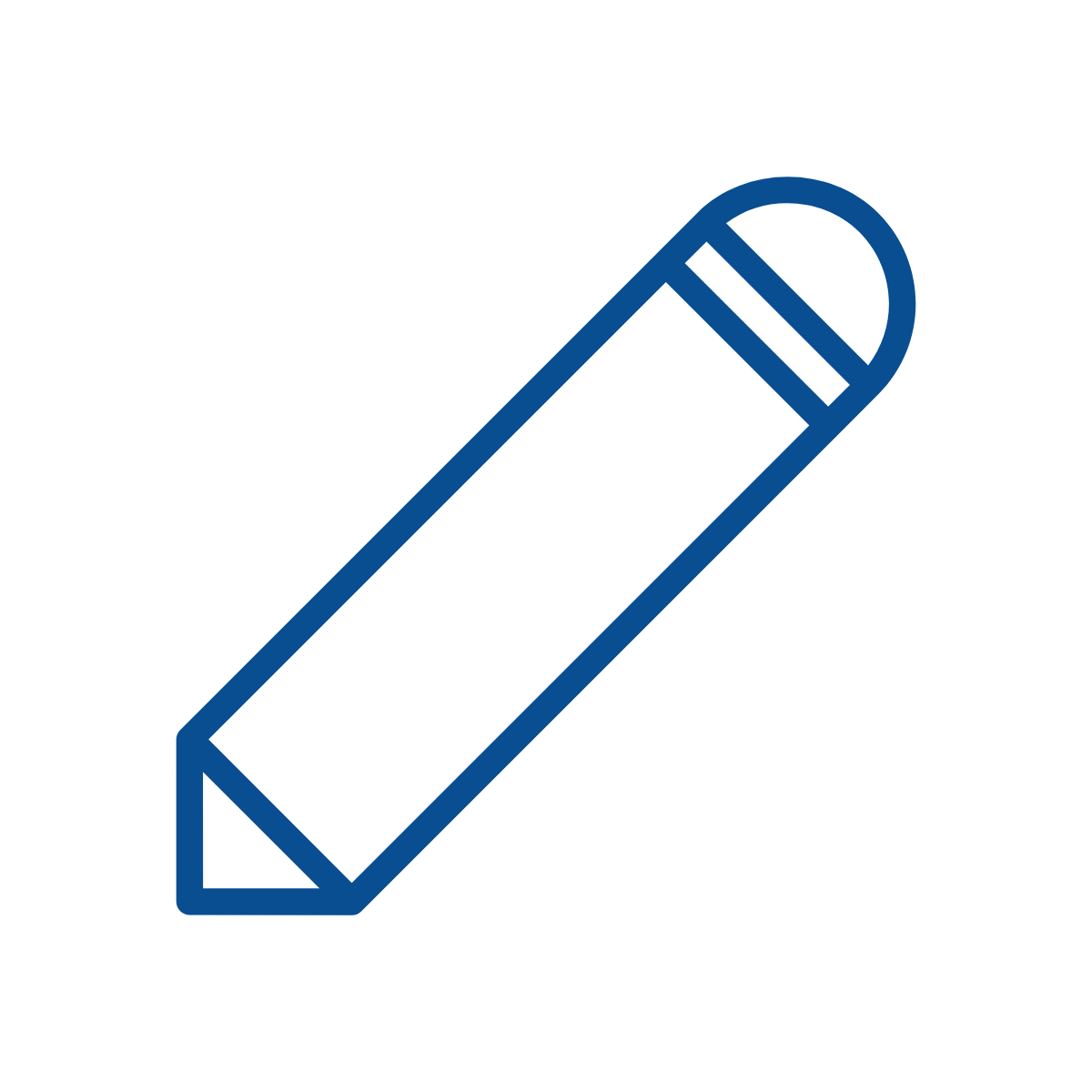Dans la même rubrique
Mathias Dewatripont a reçu, début avril, le titre de DHC de l’Université d’Anvers pour ses contributions scientifiques et de politiques publiques en matière de régulation et de supervision des institutions financières. Déjà honoré de Prix prestigieux – il a notamment reçu le Prix Francqui en 1998 et la Médaille Jahnsson en 2003 et d’aucuns parlent de lui comme un des rares belges qui pourraient un jour recevoir un Prix Nobel en Economie… – ce spécialiste de l’économie regarde le monde avec philosophie et n’oublie pas de rester discret, malgré un CV impressionnant !
Esprit libre: Denis Mukwege a reçu de l’Université d’Anvers un titre de DHC en même temps que vous pour son engagement. Vous avez deux parcours extraordinaires tous les deux et pourtant si éloignés. Quel regard portez-vous sur le sien?
Mathias Dewatripont: Denis Mukwege a reçu un DHC de l’Université, moi j’ai reçu un DHC « des facultés ». C’est donc lui qui a été, à juste titre, mis en lumière prioritairement vu son travail extraordinaire. Il est également rappelons-le, professeur à l’ULB. Il avait reçu le Prix Nobel de la Paix peu de temps auparavant, et j’avoue qu’on se sent très humble face à un parcours comme le sien qui impose le respect. D’autres DHC ont par ailleurs été attribués pour des sujets de recherche plus passionnants les uns que les autres.
EL: Votre spécialité de recherche c’est la « théorie des contrats ». Pouvez-vous nous en dire un mot, de quoi s’agit-il?
MD: En quelques mots, très brefs, je dirais que la théorie des contrats permet de comprendre comment, dans une réalité complexe et une économie de marché, les agents économiques organisent leurs relations de façon à s’assurer que celles-ci soient efficaces et que chacun ‘y trouve son compte’. Cela couvre donc également de nombreux sous-domaines de la vie réelle des banques, de leurs dettes et de leurs prêts d’argent, sujet sur lequel j’ai entamé des travaux dès les années 90, avec Jean Tirole (ndlr: Prix Nobel d’économie).
EL: Vous avez été directeur et vice-gouverneur de la banque nationale de Belgique durant 6 ans (de 2011 à 2017). Quel était votre rôle a ce niveau?
MD: J’y ai chapeauté la politique de supervision bancaire. J’ai à ce titre été nommé représentant de la Belgique au Comité de Bâle, qui propose aux principaux États du monde d’inscrire, dans leur législation, des règles bancaires qui les incitent à la prudence. J’y ai aussi assisté à la naissance de l‘Union bancaire et ai représenté la Belgique au Conseil de supervision de la BCE sur ces questions prudentielles. Ensuite je suis revenu à l’ULB, en mai 2017.
EL: Vous avez été doyen de la SBS-EM, vous êtes enseignant et vous l’avez aussi été au prestigieux MIT. Ce rôle au sein de la BNB a-t-il change votre regard sur la réalité économique?
MD: Tout d’abord – et pour l’anecdote –, je rappelle que j’ai été dans une première vie, étudiant-administrateur à l’ULB pendant un an (en 1981). À l’époque, le fonctionnement du CA était disons… d’une certaine complexité, et cette expérience a été assez formatrice pour arriver ensuite à naviguer dans ces réunions internationales aux acteurs multiples (Rires)! Concernant le lien avec la réalité économique, je dirais tout d’abord qu’au sein des entités internationales que j’ai fréquentées, assez peu de gens étaient issus du monde académique et de la recherche. J’y ai donc assez naturellement trouvé mon ‘rôle spécifique’. Quant à l’influence de la recherche académique en général, l’introduction de certaines notions issues de la recherche comme « l’aléa moral » par exemple, relative aux dangers liés aux investissements à risque, a certainement permis d‘améliorer la qualité de certains débats et prise de décisions au sein de ces institutions. Par contre, là où la recherche à encore des progrès à faire pour nourrir les choix politiques, c’est au niveau du « quantitatif »: beaucoup de régulateurs se retrouvent démunis sur les questions de la ‘calibration’ des actions à mettre en œuvre. Ce qui ouvre trop souvent la voie aux influences nationales et au lobby des banques pour influencer les débats et décisions supranationales.
EL: Vous êtes socialiste. Votre regard sur l’économie (et son enseignement) a-t-il change avec la crise de 2008 ? Et quel est pour vous le rôle de l’économiste par rapport à la politique?
MD: La crise de 2008 et ses suites ont clairement démontré l’insuffisance de la réglementation. Je n’ai jamais été un fervent défenseur du laisser-faire qui peut créer pas mal d’inégalité et d’instabilité. En 1993, nous avions publié avec Jean Tirole le livre « La réglementation prudentielle des banques » qui a, je pense, plutôt bien vieilli en matière de besoin de réglementation. Cette crise a en tout cas renforcé l’idée qu’il faut réguler plus fortement les marchés. Ce qui me frappe cependant, c’est la vitesse à laquelle on oublie les crises… Certaines banques ont à nouveau un discours moins prudent et il faut rester très vigilant. La science économique a, depuis 2008, évolué vers plus d’intérêt pour les aspects historiques et les leçons du passé. Et c’est un bien. L’Histoire qui est une de mes passions permet de remettre en perspective les choix d’aujourd’hui par rapport à ceux d’hier. Hitler se définissait dans les années 30 comme un Keynésien par exemple, alors que Keynes, qui était membre du parti libéral anglais, voulait ‘sauver’ le capitalisme des dangers fascistes et communistes en le réformant ; enfin il est aujourd’hui un économiste qu’on classe à gauche… Le rôle d’un économiste est d’éclairer les décideurs sur les conséquences économiques de leurs choix de politique qu’ils soient idéologiquement «de gauche» ou «de droite», de façon la plus objective possible.
EL: Vos deux enfants ont tous deux suivi votre voie en matière d’études…
MD: C’est exact ! Mon fils Antoine (28 ans) et ma fille Charlotte (25 ans) ont choisi la SBS-EM et ont vraiment apprécié je crois leurs études, qui restent aussi un bon passeport pour l’emploi. Le premier a d’abord choisi de voyager et s’est investi dans un premier temps dans une ONG ; il travaille aujourd’hui au Bureau du plan. Ma fille s’investit également dans ce domaine, à l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse. Tous deux font donc de l’économie appliquée.
EL: Vous avez la lecture comme passion, de quel type de littérature êtes-vous friand ? Un ouvrage à nous conseiller pour cet et?
MD: Je ne suis pas très « thrillers », je lis pas mal d’ouvrages historiques et moins de fiction. Je conseillerais le livre de Keith Lowe: «L’Europe barbare: 1945-1950». Dans les 30 «Glorieuses», il y a en réalité 5 années durant lesquelles ce sont passés des événements très durs en Europe. Or, peu d’études ont été menées sur ce sujet. On a en un sens «réécrit» l’Histoire (Plan Marshall versus Traité de Versailles après la première guerre mondiale) alors qu’une certaine anarchie a régné, avec des règlements de comptes à divers niveaux, avant le retour à une certaine normalité. Ce livre est très instructif à ce sujet. Un autre aussi que j’ai lu récemment: «1942: Het jaar van de stilte», du recteur de l’Université d’Anvers, Herman Van Goethem, qui détaille jour après jour l’occupation nazie à Anvers et le rôle des autorités et des fonctionnaires de la ville par rapport aux Juifs. C’est le genre de sujet qui fait peur, mais qui me passionne, car il oblige à une certaine lucidité sur le côté graduel et méthodique d’une descente aux enfers, et sur les attitudes individuelles à cet égard.
Alain Dauchot