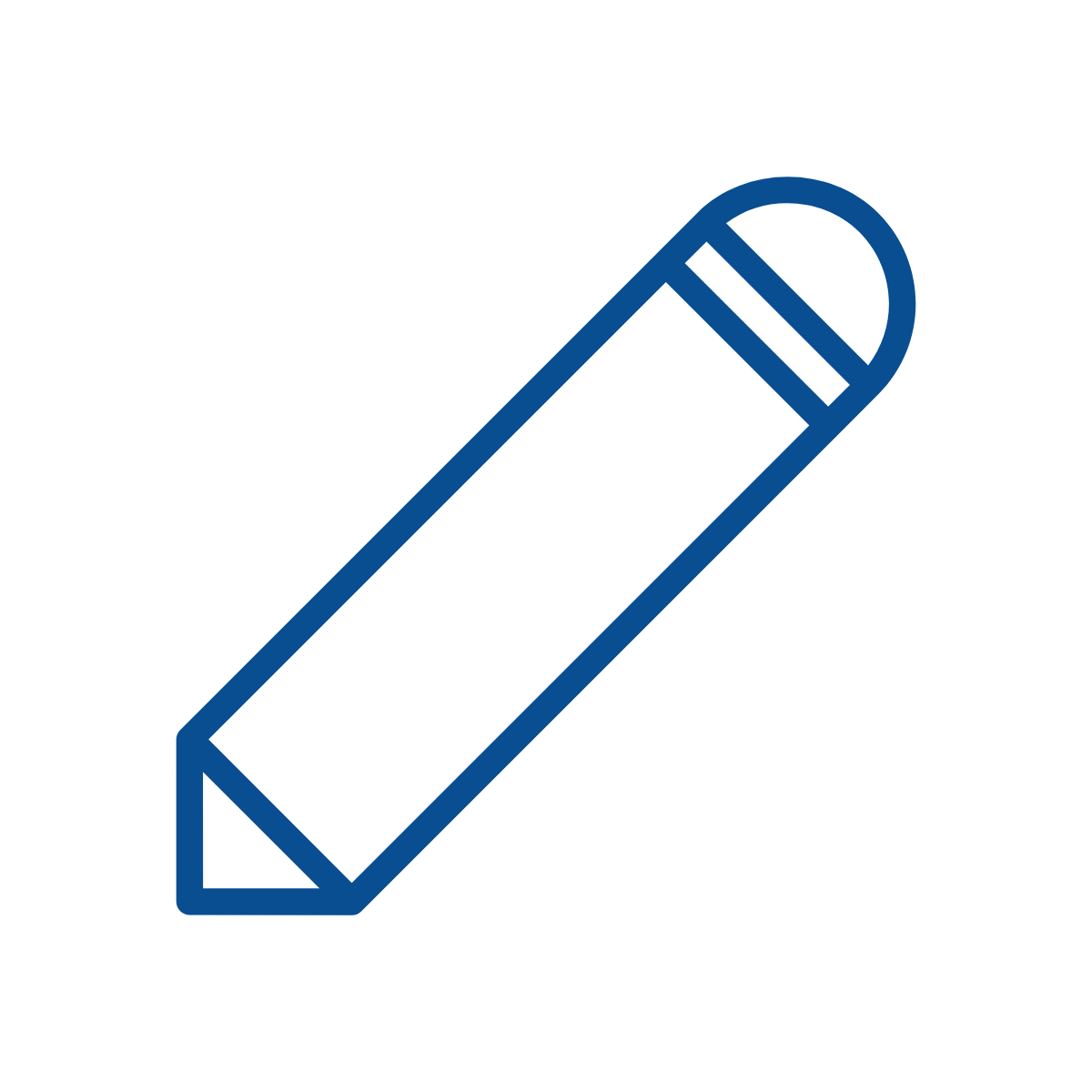Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Construire des savoirs ensemble - L'interview de Samia Ben Rajeb
Publié le 28 avril 2025
– Mis à jour le 30 avril 2025
Samia Ben Rajeb est architecte, chargée de cours à l’École polytechnique de Bruxelles, directrice du laboratoire AIA – Architecture & Architectural Engineering, BATir et depuis 2023, responsable académique ULB de l’Openlab.brussels.

« Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre les savoirs »
- Samia Ben Rajeb, responsable académique ULB de l’Openlab.brussels
On parle de recherche participative, de citizen science ou encore de recherche citoyenne. Ça veut dire quoi?
Il existe différentes formes de recherches participatives et aucun consensus strict sur les termes ou définitions qu’on leur attribue. Ce qui fait l’unanimité, en revanche, c’est leur objectif : produire de la connaissance avec des acteurs qui ne viennent pas du monde académique. Ce type de recherche implique une participation active et consciente des acteurs du terrain à une ou plusieurs étapes du processus scientifique. L’idée est de croiser expertises académiques, professionnelles et citoyennes pour répondre à deux besoins : enrichir la connaissance scientifique et répondre aux attentes sociétales par des actions concrètes issues de savoirs co-produits. Mais il faut bien comprendre que la recherche participative est un moyen, pas une finalité en soi.Cette distinction entre le moyen et la fin reflète votre parcours professionnel…
En effet, je ne me suis pas dit: «Je vais travailler sur la recherche participative.» Mon parcours m’a progressivement amenée à questionner ma pratique, les liens entre disciplines et l’impact concret des recherches sur le terrain. Pour moi, la transdisciplinarité et la co-production de connaissances avec les acteurs de terrain sont essentielles. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre savoirs théoriques et savoirs expérientiels. Aujourd’hui, avec les transitions socio-écologique et numérique, le terrain évolue indépendamment de la recherche. Il ne s’agit pas d’attendre que la science avance pour agir, mais de co-produire des connaissances qui permettent une transformation adaptée à un contexte en mutation. Il reste cependant encore beaucoup de balises à poser et de reconnaissance à obtenir pour ces approches.
Comment la recherche participative se traduit-elle concrètement dans vos projets?
Ces approches peuvent s’appliquer à de nombreuses disciplines. Dans mon cas, plusieurs projets illustrent cette démarche. Par exemple, P@trimonia, un projet financé par Wallonie-Bruxelles International, en collaboration avec l’ULiège et l’Université de Carthage et les asbl «Édifices & Mémoires» et «l’Architecture qui dégenre», vise à valoriser un patrimoine invisibilisé grâce à une application participative et géolocalisée. J’ai également travaillé sur deux projets soutenus par l’Unesco: Parle-moi d’elle, qui permet aux habitants de faire découvrir leur patrimoine à travers des récits, et L’Observatoire collaboratif du patrimoine, où le recensement du bâti est réalisé par des habitants engagés. Enfin, dans un autre projet soutenu par Innoviris, nous développons, en collaboration avec les acteurs de la construction, un outil de suivi du rendement sur chantier, lié à une maquette numérique et conçu via des living labs.
S’impliquer dans une démarche de co-construction des savoirs implique de sortir du cadre académique. Quels défis cela pose-t-il?
Produire un savoir ancré dans la réalité du terrain signifie adopter une vision intégrative et écosystémique qui prend en compte la complexité des enjeux. Mais cela implique aussi des questionnements cruciaux sur notre posture en tant que chercheurs et chercheuses universitaires. Quel est le statut de celles et ceux qui participent à la recherche sans être universitaires? Comment reconnaître leurs savoirs et contributions? Comment éviter l’instrumentalisation et assurer une reconnaissance de leur apport à la recherche? Ça nécessite aussi une méthodologie adaptée à la réalité du terrain. Il faut cadrer ensemble la visée de la recherche, construire un langage commun, créer un climat de confiance, etc. Tout cela demande du temps, des ressources, des interactions constantes et un effort de coordination. Or, ces activités de collaboration et de transfert de savoirs relèvent de la «troisième mission» de l’Université – Services à la collectivité – et restent encore trop peu valorisées dans le parcours académique.
L’Openlab.brussels, dont vous êtes la responsable académique à l’ULB, joue-t-il un rôle dans ces réflexions?
Oui, l’Openlab.brussels est un espace dédié aux recherches participatives. C’est d’abord un lieu physique où se retrouvent chercheurs, citoyens et professionnels intéressés par ces démarches. Mais c’est aussi une plate-forme Web qui permet d’échanger, de structurer des collaborations et d’étendre notre réseau au niveau international. Nous y organisons des événements, des colloques, des ateliers et des living labs pour nourrir ces réflexions, valoriser ce type de savoir et partager les retours d’expérience.
Nathalie Gobbe, Département de la communication et des relations extérieures