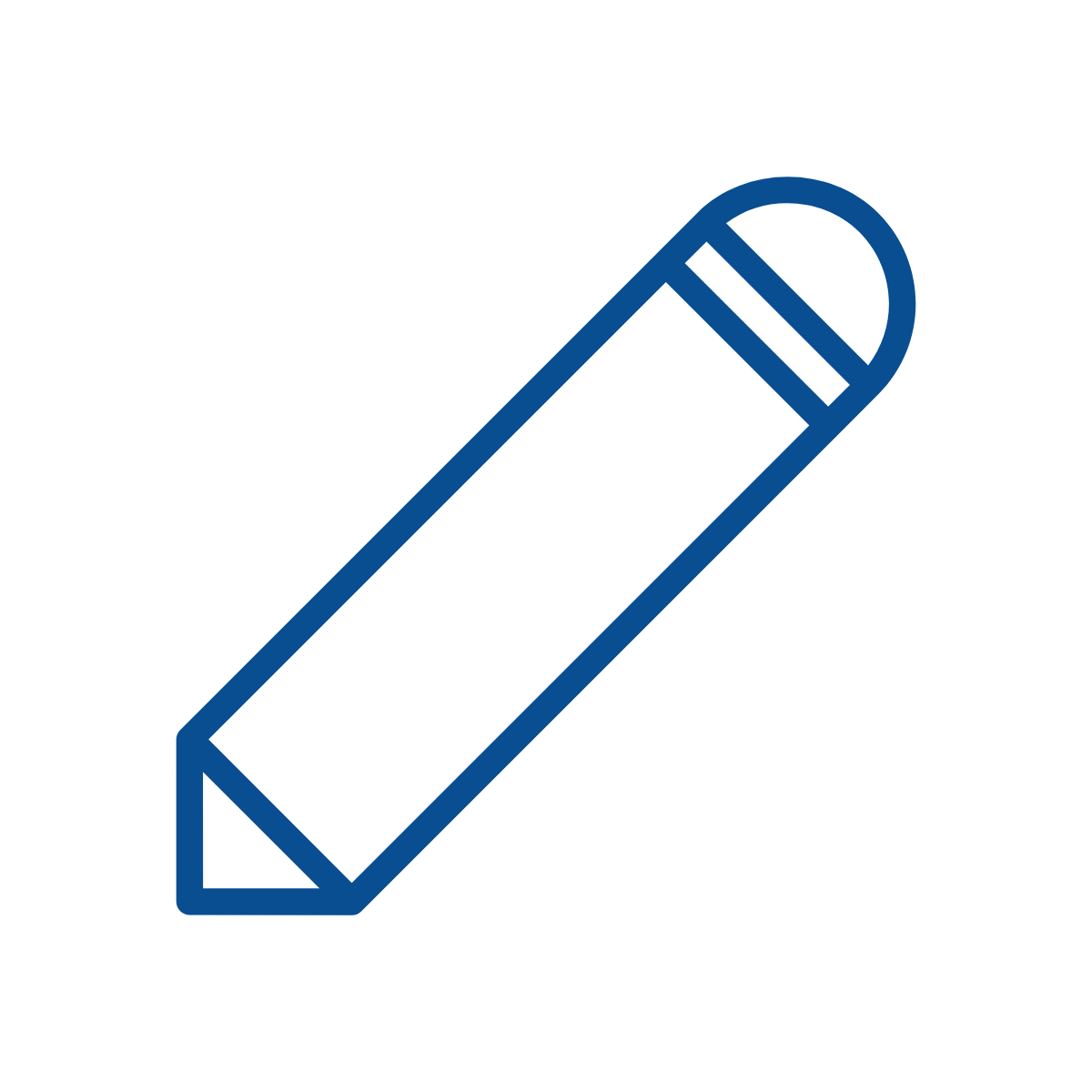Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Évaluation continue, reflet d’une Université déjà en mouvement
Le 16 juillet dernier, la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret qui pourrait bien partiellement changer le visage de l’enseignement supérieur. Le décret officialise notamment l’évaluation continue, reconnaissant une pratique déjà présente sur le terrain, mais encore peu encadrée. Ce nouveau décret nous amène à nous (re)poser une question fondamentale: comment voulons-nous que nos étudiants apprennent, progressent et réussissent?
En effet, elle permet aux étudiants de se situer, de comprendre leurs forces et faiblesses, de progresser pas à pas. Elle leur offre des repères, des retours réguliers, des occasions de s’impliquer de manière continue. En cela, elle est particulièrement précieuse pour des publics diversifiés, parfois peu au fait des codes intrinsèques de l’université. Mais l’évaluation continue est aussi un miroir pour les enseignants: elle les oblige à interroger leurs dispositifs, à écouter les retours, à ajuster leurs méthodes. Si une notion est incomprise par l’ensemble d’un groupe, n’est-ce pas leur pédagogie qui doit évoluer? En cela, l’évaluation continue renforce le lien, l’attention, l’adaptabilité.
Cependant, et il est bon de le rappeler, l’évaluation continue est une modalité parmi d’autres au service d’une finalité pédagogique. Elle relève de la liberté académique et de la responsabilité collective, et non de l’injonction à une refonte aveugle des méthodes en place.
Accompagner la transition
La première année sur les bancs de l’université est souvent une épreuve. Entre liberté soudaine, décalage culturel et exigence académique, elle peut désorienter. Pendant longtemps, le premier « vrai » examen universitaire arrivait tard, parfois trop tard, alors que les routines d’apprentissage des étudiants n’étaient pas encore balisées ou consolidées.
L’évaluation continue, bien pensée, permet de structurer cette phase délicate. Elle rend les exigences plus explicites, plus progressives, sans abaisser le niveau. Elle favorise une montée en autonomie, une meilleure compréhension des attendus pédagogiques et disciplinaires et assure une régularité dans le travail. En cela, elle vient renforcer les dispositifs d’accompagnement aux apprentissages existants de l’ULB tels que Ma Première Année Sur Mesure (PASM), les séances de tutorat, ou les bureaux pédagogiques: autant d’initiatives déjà au service de la réussite.
« Mais l’évaluation continue est aussi un miroir pour les enseignants : elle les oblige à interroger leurs dispositifs, à écouter les retours, à ajuster leurs méthodes. »
Une trajectoire déjà engagée
Loin d’être une réaction au nouveau décret, cela fait des années que l’évaluation continue s’immisce, confidentiellement, dans l’enseignement supérieur. À l’ULB, elle prend de multiples formes: projets en petits groupes, présentations orales, évaluations formatives, TP, séminaires, cliniques, portfolios…Ces pratiques sont parfois peu visibles, peu reconnues, ou mises en place de manière isolée. Un exemple parmi tant d’autres, le professeur Pieter Lagrou de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales a mis en place un dispositif d’évaluation continue pour sa cohorte de bacheliers, avec le soutien du Fonds pour facultaires), responsables de programme, jurys, membres du corps académique et scientifique, étudiantes, personnel administratif: toutes et tous ont un rôle à jouer dans cette dynamique. Du côté des enseignants, elle suppose un investissement supplémentaire : en temps, en préparation, en concertation, en correction. Elle appelle une coordination renforcée entre collègues, pour éviter chevauchements, surcharges et incohérences qui viendraient affaiblir l’intention pédagogique. Du côté des étudiants, une modalité d’évaluation mal calibrée peut générer une pression continue, une perte de lisibilité, voire une dispersion du sens. D’où l’importance d’un cadrage explicite, progressif, intelligemment articulé à l’ensemble du parcours. C’est précisément ce que vise le cadre proposé par l’ULB : associer les facultés à une réflexion coordonnée, renforcer la cohérence des programmes, garantir une articulation fluide entre les dispositifs d’évaluation, assurer une gestion juste et souple des absences et accompagner les équipes enseignantes dans la mise en œuvre, tant sur le plan pédagogique que logistique. « Mais l’évaluation continue est aussi un miroir pour les enseignants: elle les oblige à interroger leurs dispositifs, à écouter les retours, à ajuster leurs méthodes. » l’Encouragement à l’Enseignement. Le projet, salué tant par les étudiants que par les pairs, prouve qu’avec une bonne préparation, un accompagnement adéquat et une volonté claire, cette modalité est applicable même dans des contextes a priori peu propices. Cette démarche est aussi l’occasion de visibiliser des pratiques déjà à l’œuvre dans de nombreuses unités d’enseignement, souvent développées de manière autonome, parfois isolée, mais toujours guidées par la volonté d’offrir un meilleur accompagnement aux étudiants. Les valoriser, les structurer, les inscrire dans une dynamique institutionnelle lisible : c’est aussi cela, construire l’Université dont nous rêvons. L'ULB n'a pas attendu un décret pour s'engager. Mais ce décret, en rendant légitime ce qu'elle expérimentait déjà, offre une occasion à ne pas manquer: commencer à penser ce qu'elle veut faire de l’évaluation, pour ensuite aller plus loin et étendre cette réflexion à l’ensemble de la mission d’enseignement. Mais cette réussite ne doit pas être généralisée sans précaution. Ce qui fonctionne ici, à un moment donné, n’est sans doute pas transposable ailleurs. En effet, un cours de 20 étudiants n’est pas un auditoire de 1.000. Et le droit n’est pas la biochimie. La logique doit rester celle de l’expérimentation, de la concertation, du surmesure. L’un des enjeux majeurs est donc de visibiliser cet existant, d’en reconnaître la légitimité, d’en tirer des enseignements. Il s’agit de créer un écosystème favorable à leur développement, sans en faire un standard obligatoire. C’est la diversité des formats, l’adaptation aux disciplines, la cohérence à l’échelle des programmes qui doivent guider l’action.
Enjeux et garde-fous
L’évaluation continue n’est pas un gadget pédagogique. Elle peut devenir un levier stratégique au service de la mission de l'Université, à condition d’être pensée avec rigueur, portée collectivement, et accompagnée avec discernement. Doyens et doyennes (ou autorités facultaires), responsables de programme, jurys, membres du corps académique et scientifique, étudiantes, personnel administratif : toutes et tous ont un rôle à jouer dans cette dynamique.Du côté des enseignants, elle suppose un investissement supplémentaire: en temps, en préparation, en concertation, en correction. Elle appelle une coordination renforcée entre collègues, pour éviter chevauchements, surcharges et incohérences qui viendraient affaiblir l’intention pédagogique. Du côté des étudiants, une modalité d’évaluation mal calibrée peut générer une pression continue, une perte de lisibilité, voire une dispersion du sens. D’où l’importance d’un cadrage explicite, progressif, intelligemment articulé à l’ensemble du parcours.
C’est précisément ce que vise le cadre proposé par l’ULB: associer les facultés à une réflexion coordonnée, renforcer la cohérence des programmes, garantir une articulation fluide entre les dispositifs d’évaluation, assurer une gestion juste et souple des absences et accompagner les équipes enseignantes dans la mise en œuvre, tant sur le plan pédagogique que logistique.
Cette démarche est aussi l’occasion de visibiliser des pratiques déjà à l’œuvre dans de nombreuses unités d’enseignement, souvent développées de manière autonome, parfois isolée, mais toujours guidées par la volonté d’offrir un meilleur accompagnement aux étudiants. Les valoriser, les structurer, les inscrire dans une dynamique institutionnelle lisible: c’est aussi cela, construire l’Université dont nous rêvons.
L'ULB n'a pas attendu un décret pour s'engager. Mais ce décret, en rendant légitime ce qu'elle expérimentait déjà, offre une occasion à ne pas manquer: commencer à penser ce qu'elle veut faire de l’évaluation, pour ensuite aller plus loin et étendre cette réflexion à l’ensemble de la mission d’enseignement.
Oui, cela demande du temps. Oui, cela suppose du dialogue, de l’écoute, de la nuance. Mais l’enjeu en vaut la peine, car derrière cette modalité, c’est une certaine idée de l’ULB qui se dessine: plus humaine, plus exigeante, plus attentive. Une Université qui accompagne sans infantiliser, qui structure sans contraindre, qui innove sans renier ses fondements.
Jérémy Jenard
Article rédigé sur base d’un entretien avec Valérie Piette, vice-rectrice à l’enseignement, à la qualité et aux apprentissages.