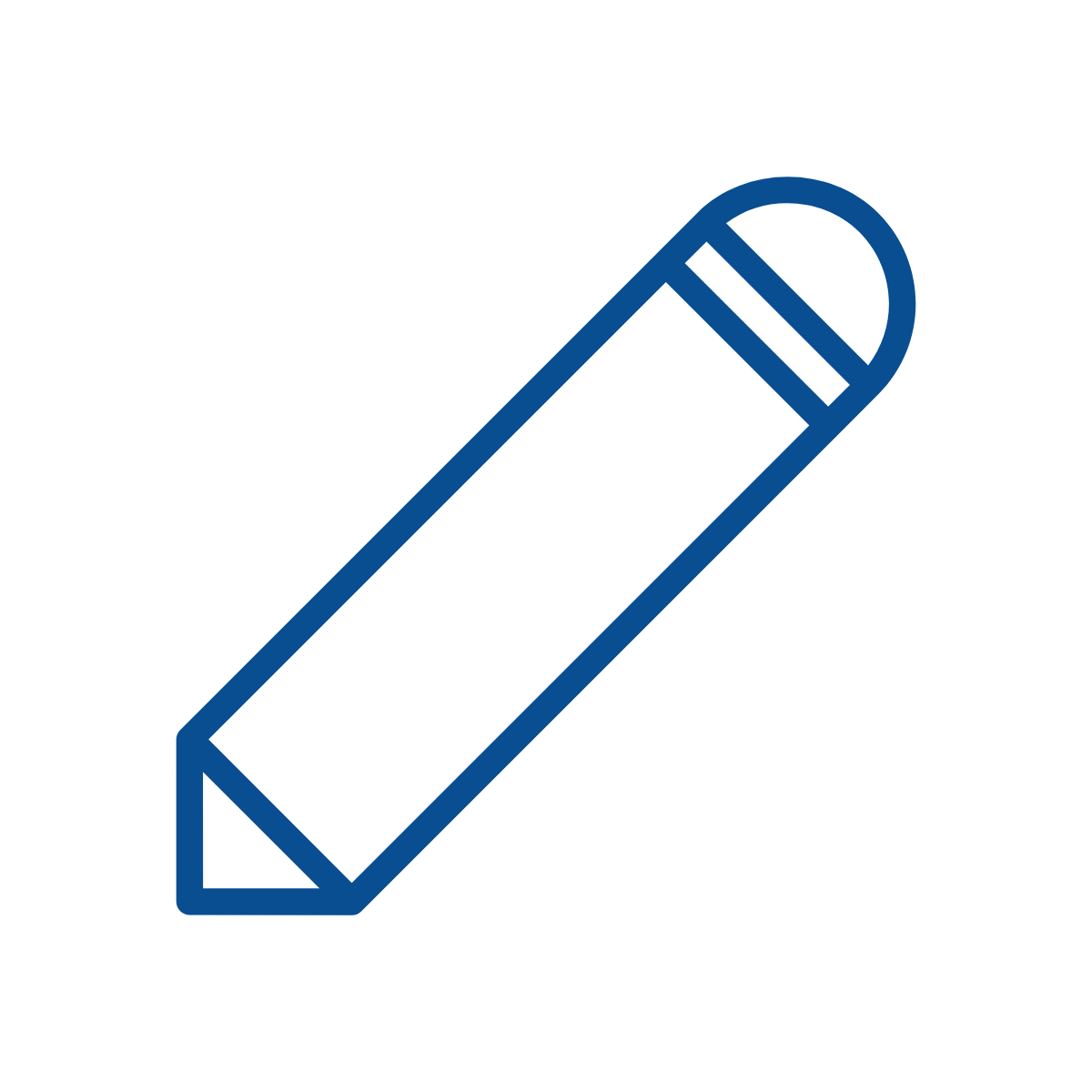Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Isidore Ndaywel è Nziem: le bâtisseur de mémoire congolaise
L’ULB a eu l’honneur d’accueillir au printemps, dans le cadre d’une chaire internationale, le professeur Isidore Ndaywel è Nziem, historien et linguiste congolais, figure majeure de l’historiographie congolaise contemporaine. Son œuvre, notamment Histoire générale du Congo : de l’héritage ancien à la République démocratique, met en lumière la richesse et la complexité de l’histoire congolaise, tout en interrogeant les défis politiques, sociaux et culturels du pays. Interview.

« Les historiens ont pour mission d’éclairer les contemporains sur les enjeux réels auxquels ils sont confrontés. »
Qu’est-ce qui vous a conduit à devenir historien?
C’est un excellent professeur du secondaire qui m’a initié à l’histoire mais c’est à Paris que j’ai véritablement découvert l’histoire africaine, grâce à des maîtres tels qu’Hubert Deschamps, Yves Person, Georges Balandier ou Henri Moniot. J’ai soutenu ma thèse de doctorat en histoire à la Sorbonne en 1972, après une licence de Philosophie et Lettres à l’Université de Kinshasa. Depuis 1973, je conjugue les métiers d’écrivain et de professeur d’histoire.
Quelles ont été les étapes marquantes de votre carrière professionnelle?
J’ai débuté à Lubumbashi, au sein de la seule Faculté des lettres de l’Université nationale du Zaïre, où j’ai été le premier Congolais à enseigner l’histoire et à diriger le département. J’y ai fondé le CERDAC (Centre de recherche et de documentation sur l’Afrique centrale). Au début des années 1980, lors de l’autonomisation des universités, j’ai rejoint Kinshasa comme Secrétaire permanent du Conseil d’administration des universités. J’ai ensuite dirigé un mandat à l’Organisation internationale de la francophonie à Paris, avant de revenir à Kinshasa pour coordonner scientifiquement le Commissariat général du Cinquantenaire de l’Indépendance et organiser le XIVe Sommet de la Francophonie.
Quels sont les principaux domaines de recherche que vous avez explorés?
Je me consacre à l’histoire sociale et culturelle de l’Afrique centrale, avec un intérêt particulier pour la période précoloniale. Toutefois, l’écriture de l’histoire m’a amené à explorer d’autres périodes, et aujourd’hui, j’aborde l’histoire de l’Afrique centrale dans sa globalité.
L’histoire précoloniale a un impact majeur sur l’histoire contemporaine, constituant le socle de la période coloniale. Sans une étude approfondie de ces deux périodes, il est difficile de comprendre des phénomènes comme l’ethnicité ou les conflits intra-africains.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être titulaire d’une chaire internationale?
C’est à la fois un privilège et une responsabilité. Être élu à cette chaire est un honneur mais c’est aussi un devoir de répondre aux attentes de l’institution, des collègues et des étudiants. Cette chaire me permet d’échanger avec mes pairs et d’avancer sur mes propres projets de recherche, notamment un nouvel ouvrage sur le Congo.
Pouvez-vous nous parler des activités et des projets que vous avez menés, à l'ULB, dans le cadre de cette chaire?
J’ai participé à des enseignements et séminaires avec les Pr. Serge Jaumain (Faculté de Philosophie et Sciences sociales) et Judith le Maire (Faculté d’Architecture La Cambre Horta), donné une leçon publique pour les étudiants de droit et d’histoire contemporaine, et animé une conférence intitulée « Nouveaux regards sur l’histoire du Congo ». Un séminaire à la Faculté d’Architecture m’a permis de rencontrer des chercheurs de l’ULB et du Musée royal d’Afrique centrale, issus de diverses disciplines et qui mènent des recherches sur le Congo historique et contemporain. J’ai également visité les archives africaines transférées en métropole avant l’indépendance du Congo, aujourd’hui conservées aux Archives de l’État.
Comment votre travail en tant qu’historien a-t-il influencé votre engagement politique?
L’engagement s’est imposé naturellement car l’histoire fonde la conscience historique. Et la conscience historique est la fille aînée de la conscience nationale et panafricaine.
Comment voyez-vous le rôle des historiens dans le débat politique social et politique?
Les historiens ont pour mission d’éclairer les contemporains sur les enjeux réels auxquels ils sont confrontés, puisqu’ils sont capables de mettre le présent en perspective avec le passé et l’avenir.
Selon vous, quels sont les défis politiques majeurs auxquels l’Afrique et la République démocratique du Congo (RDC) sont confrontés aujourd’hui?
La RDC est confrontée à la nécessité de construire un État qui puisse garantir la paix, la sécurité et le bien-être de sa population. Quant à l’Afrique, elle doit œuvrer à son unité, indispensable dans le contexte de la mondialisation.
Séverine Vaissaud