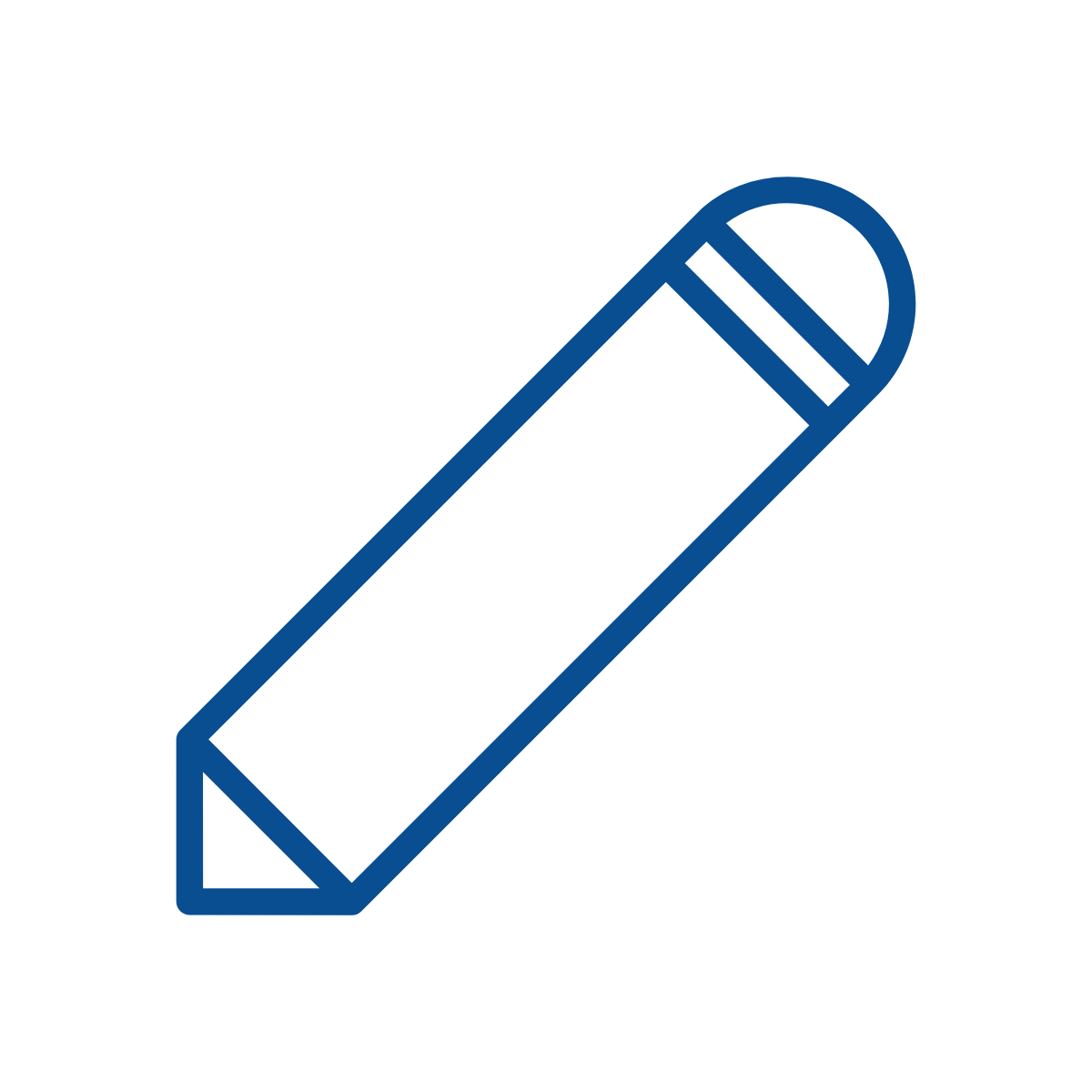Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Portrait de Kim Oosterlinck
Publié le 29 avril 2025
– Mis à jour le 30 avril 2025
Professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management, Kim Oosterlinck est depuis juillet 2024 directeur des Musées royaux des beauxarts. Ce diplômé de Solvay et d’archéologie, allie ainsi ses passions, lui qui a aussi été pendant sept ans vice-recteur à la prospective et au financement de l’ULB. Après plusieurs mois à la tête de cette institution fédérale regroupant notamment les musées Magritte, Oldmasters, Wiertz, Meunier, il déborde d’enthousiasme. Ce qui l’a le plus surpris? «La complexité du fonctionnement en coulisses, finalement pas si lointaine de celle de l’ULB.»
« Les artistes et les chercheurs ont besoin des mêmes ingrédients. »
- Kim Oosterlinck
D’où vous vient cet attrait pour l’art?
L’environnement familial a été important. Ma maman nous emmenait petits dans les musées et nous racontait des histoires autour des œuvres. Ado, j’ai continué à être attiré par l’art mais aussi l’archéologie. En amateur, j’ai participé à plusieurs fouilles, notamment à Stavelot.
Qu’est-ce qui rapproche art et science?
Les bons artistes et les bons chercheurs ont besoin des mêmes ingrédients: créativité, curiosité, innovation, envie de repousser les limites… À l’ULB, Karine Van Doninck (NDLR: chercheuse en biologie évolutive collaborant avec des artistes) et Marius Gilbert (NDLR: vice-recteur à la recherche mais aussi à la culture et à la médiation scientifique) réfléchissent beaucoup à ces liens entre art et science. Le grand public a souvent tendance à réduire la recherche à des gens en blouse blanche travaillant sur le cancer. Mais il y a des recherches passionnantes dans bien d'autres domaines, y compris en histoire de l’art.
Comment l’ULB a façonné votre façon de voir l’art?
Les enseignements, à l’ULB, proposent une approche factuelle qui ancre le savoir, et permet ensuite de poser le regard. Le façonnage a donc été sur l’aspect scientifique de l’art, plutôt que sur l’approche esthétique. Pour cette dernière, chacun développe son propre rapport aux œuvres. C’est un chemin personnel, difficile à enseigner, et qui évolue au fil du temps. Ce qui est agréable dans ma fonction, c’est que je découvre régulièrement de nouveaux artistes. Celui que je préfère ? Peut-être celui que je n’ai pas encore rencontré.
Que retenez-vous de vos années en tant que vice-recteur?
C’était extrêmement intéressant. À cette place, on voit toutes les facettes de l’Université et on en comprend sa complexité, sa richesse. Et puis, en termes de gestion de dossiers et d’enjeux, c’est très formateur. J’ai appris des tas de choses et j’ai surtout découvert qu'il y a un personnel formidable à l'ULB, avec des personnes hyper motivées et fondamentalement attachées à l’Université. C’est précieux.
Qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre les musées royaux?
Une amie m’a fait remarquer que j’avais le profil idéal. J’ai passé les nombreux tests Selor et plus j’avançais, plus je me projetais. J’avais plusieurs caractéristiques qui plaidaient en ma faveur: cette double formation, une pratique de la gestion en tant que vice-recteur et le côté académique pour comprendre les aspects liés à la recherche auxquels est confrontée cette institution scientifique. Et puis, jeune déjà, j’allais souvent voir ce musée. Ça a créé un lien, une complicité. Il y a là une âme qui me parle.
Quelles sont vos priorités en tant que nouveau directeur?
D’abord, la rénovation de certaines parties du bâtiment. Les budgets sont là et il faut maintenant avancer. L’autre grand challenge, c’est de couvrir à nouveau les périodes du XVe au XXIe siècle et de présenter différentes formes d’art, alors qu’on a essentiellement des peintures exposées actuellement. Je voudrais retrouver davantage de diversité dans les œuvres, mais aussi dans le public. Quand on rentre dans le forum aujourd’hui, on découvre essentiellement des créations d’artistes hommes blancs. Il faut faire évoluer cela, montrer que ce musée est celui de tous et faire en sorte que chacun s’y sente bien. Et de ce point de vue, l’architecture, même si elle est fantastique, nous dessert par sa monumentalité.
Face aux menaces de réduction des financements publics, comment vous positionnez-vous?
Les finances publiques sont ce qu’elles sont. Il va falloir faire des économies et malheureusement, il n’y a pas de raison que les musées soient exemptés. On doit développer des sources de financement alternatives. J’ai des contacts avec des sponsors potentiels. Par exemple, pour la Fashion Week de mars dernier, nous avons collaboré avec le maroquinier Delvaux en prêtant The Americans de Saul Steinberg (1914-1999), une œuvre créée pour le Pavillon américain lors de l’Expo 58.
Les musées peuvent-ils être vecteurs de la pensée libre exaministe?
C’est plus général. Les musées doivent avoir une fonction sociétale, en matière de libre examen mais pas que. On peut faire cela de façon assez subtile. En partenariat avec le Palais des beaux-arts de Lille et le Louvre, on a ainsi monté une expo sur les kermesses flamandes du XVIe et XVIIe siècles (NDLR: à voir jusqu’au 1er septembre, pba.lille.fr). Cette période a été marquée par de nombreux conflits et il y a donc un questionnement qui peut raisonner avec l’actualité: «Peut-on s’amuser en temps de guerre?» Un musée n’est pas juste une expérience esthétique. C’est un lieu de réflexion et de rencontres.
Fanny Bouvry, Département de la communication et des relations extérieures