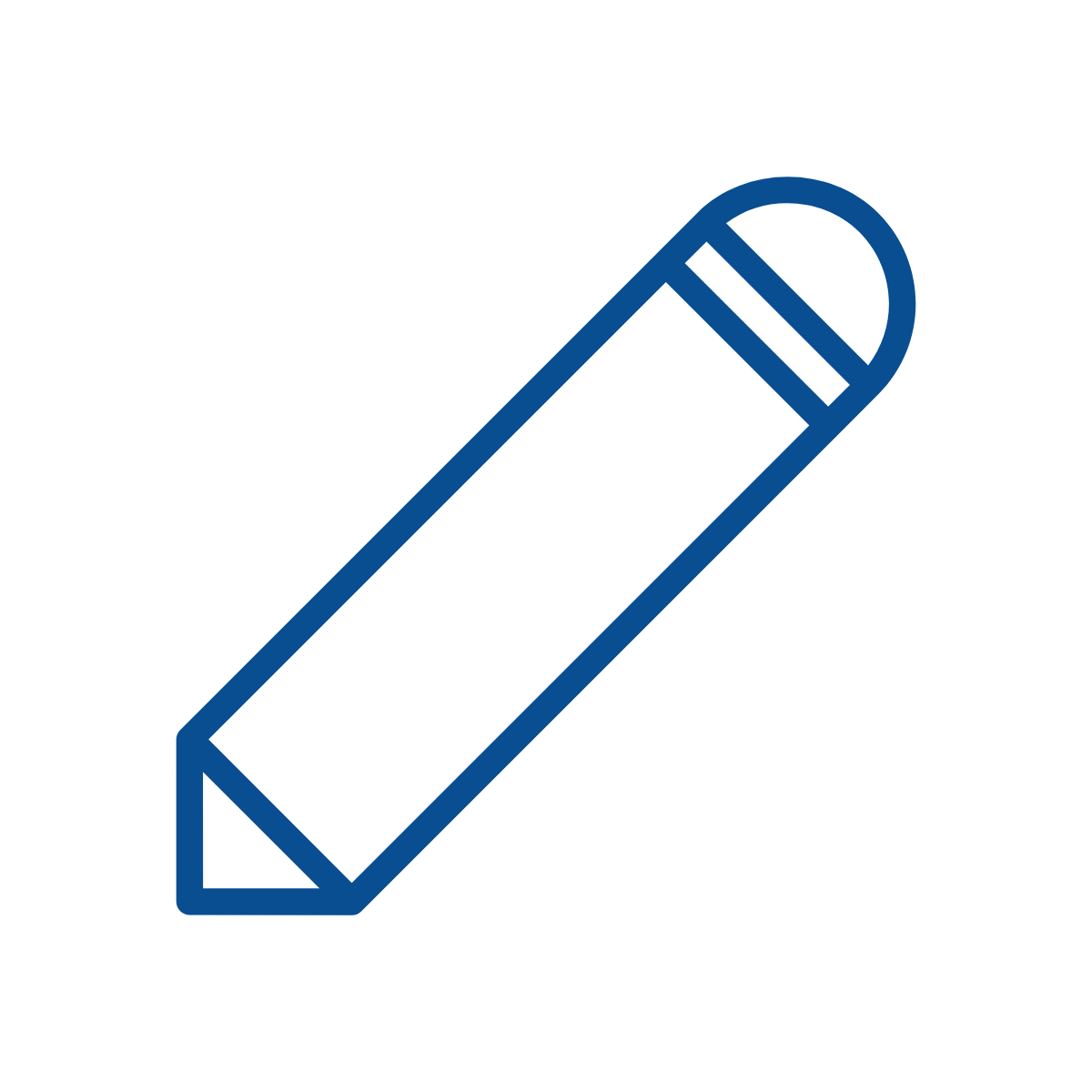Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Comment la « double peine » du projet de loi immigration renforce la confusion des pouvoirs
Un article de Julien Fischmeister, Centre de recherches de Droit pénal, Faculté de Droit et de Criminologie, dans The Conversation.
Objet de la crise politique majeure de cette fin d’année, le projet de loi sur l’immigration doit être examiné en commission mixte paritaire ce 18 décembre 2023.
Alors que le dissensus entre le gouvernement et les parlementaires de la droite porte sur certaines mesures à haute visée symbolique (régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers dits « en tension », suppression de l’aide médicale de l’État, etc.), l’entente semble plus grande sur le renforcement de la « double peine ». Pourtant, ces mesures n’en sont pas moins inquiétantes pour ce qu’elles disent des rapports entre les pouvoirs exécutif et judiciaire, et plus largement du lien entre peine et expulsion.
« Méchant avec les méchants »
« L’aménagement de peine n’est possible que pour les Français qui, sortant de prison, veulent ou doivent se réintégrer à la société française. Ce qui n’est pas la vocation de l’étranger, qui lui doit quitter le territoire ».
La messe était dite par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, vendredi 1er décembre 2023, lors de l’examen du projet de « loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Pour anodines qu’elles paraissent, ces déclarations résument en réalité la teneur du projet politique réservé aux étrangers auteurs d’infractions, et plus largement l’ambition affichée par le ministre d’être « méchant avec les méchants ».
Une sévérité justifiée par une criminalité étrangère prétendument endémique, pourtant démentie tant par la recherche que par la statistique pénale. Cette dernière établit notamment qu’en plus de ne représenter que 16 % des condamnations, les étrangers sont dans près de 98 % des cas auteurs de délits le plus souvent liés à une plus forte précarité socio-économique.
Délinquant étranger, étranger délinquant
Pour s’assurer qu’à la sanction pénale suive l’expulsion – ce qu’une vaste campagne associative a popularisé comme « double peine » au début des années 2000 –, le gouvernement entend faire voter plusieurs dispositifs qui soulignent l’incompatibilité entre les objectifs du pouvoir exécutif et ceux de l’institution judiciaire. Car cette dernière ne fait, à tout le moins officiellement, aucune distinction à raison de la nationalité dans les fonctions de la peine.
De façon assez inédite, est donc clairement assumée l’idée d’un dédoublement de la finalité punitive : réhabilitatrice pour les uns, relégatoire pour les autres. Ainsi s’achève la mue, déjà entamée par un empilement de normes répressives ces dernières décennies, du délinquant étranger – à réinsérer tant bien que mal – en étranger délinquant – à expulser coûte que coûte.
Il est, dans ce contexte, saisissant de relire Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, affirmer en 2003 à l’Assemblée nationale que :
« ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas la nationalité française […] que ses chances de réinsertion doivent être à jamais compromises et que sa famille doit être punie avec elle. Un même délit doit entraîner une même peine pour tous, ni plus ni moins. »
Accusé à tort d’avoir aboli la double peine, le ministre n’avait en réalité fait qu’introduire dans la loi de nouvelles catégories d’étrangers pouvant s’en prémunir. Des garanties qui, pourtant pensées pour protéger la vie privée et familiale, sont aujourd’hui menacées jusque dans leur principe même.
Instrumentalisation du pénal
Alors qu’existent depuis 1981 une série de protections (dites « relatives » ou « quasi-absolues ») contre l’arrêté d’expulsion, étendues en 1989 à l’interdiction judiciaire du territoire français (ITF), la loi actuellement en vigueur prévoit qu’une partie d’entre elles (celles « relatives » en matière d’expulsion) peuvent être écartées lorsque l’étranger a été condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement.
Or par une subtilité qui aura échappée au plus grand nombre, le projet de loi non seulement étend cette exception à l’ensemble des protections contre l’arrêté d’expulsion et l’ITF, mais surtout l’applique en cas de condamnation pour une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement (ou dix ans pour les protections « quasi-absolues ») ainsi qu’en cas de violences intrafamiliales. Et ce, quel que soit la durée et le type de sanction réellement décidés par le juge au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Cette atteinte à l’individualisation de la peine est d’autant plus préoccupante que l’écart entre les peines prononcées et celles encourues est massif en matière délictuelle. Selon l’économiste Arnaud Philippe en effet, « les peines prononcées ne représentent en moyenne que 8 % de l’encouru, 4 % si on ne prend que la partie ferme ».
Pour prendre exemple sur l’ex-président de la République susmentionné, la loi autorisait la Cour d’appel de Paris à prononcer une peine de dix ans d’emprisonnement plutôt que celle de trois ans, dont un ferme, finalement décidée.
L’appel d’air de la répression
Fatalement, ce passage d’un registre des peines prononcées à celui des peines encourues fait également entrer dans le spectre répressif immensément plus de personnes : en 2021, 853 étrangers ont été condamnés à cinq ans de prison (ou plus), mais plus de 30 000 pour une infraction punie d’au moins autant (contre plus de 116 000 Français). Le spectre pourrait s’étendre encore davantage en cas d’abaissement du seuil de l’encouru à trois ans (et cinq ans pour les protections « quasi-absolues »), comme l’avait décidé la commission des lois du Sénat.
Un terrain d’entente doit également être trouvé sur l’extension des délits permettant au juge de prononcer une ITF. Alors que le gouvernement en ajoutait trois (violences légères à l’encontre du conjoint, violences à l’encontre des forces de l’ordre, vol avec une circonstance aggravante) à une liste déjà longue de plusieurs centaines d’infractions, le Sénat a souhaité inclure tous ceux punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. Quelle que soit l’option retenue, est encore exalté le potentiel bannissant de l’infraction et détournée la finalité de la peine.
Ordre public et arbitraire
La perte en puissance du pénal semble dans le même temps bénéficier à l’administration, qui verrait sa faculté de mobiliser la « menace pour l’ordre public » à l’appui d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ouverte en 2016, encore débridée.
Dénuée de toute définition juridique, cette notion est laissée à la libre appréciation des préfets et présente donc un réel risque d’arbitraire. Des faits de corruption active, par exemple, pourront dans certains cas être considérés comme menaçant l’ordre public, mais pas un vol simple (ou inversement). Si sa validité constitutionnelle tient notamment à la satisfaction théorique d’une double exigence de proportionnalité et de motivation, le Conseil d’État estime pour sa part, de longue date, que la « menace pour l’ordre public » ne peut se fonder sur la seule existence d’une condamnation pénale, mais doit prendre en compte la situation actuelle de l’individu dans sa globalité.
Toutefois, le caractère nébuleux de l’ordre public permet au préfet d’invoquer une telle menace de façon à la fois stéréotypée et automatisée à la moindre interaction avec la justice pénale – parfois même en l’absence d’infraction. C’est ainsi qu’un ressortissant bangladais à récemment fait l’objet d’une telle qualification suite à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vente à la sauvette, et d’une amende de 640€ pour conduite sans permis. Les exemples sont légion.
L’OQTF détournée de son objet initial
Néanmoins certains garde-fous limitaient encore un tant soit peu son usage excessif. En 1989, les protections contre l’expulsion furent également étendues à la reconduite à la frontière (ancêtre de l’OQTF) et ne souffrent depuis d’aucune exception. Ainsi, les parents d’enfants français, les étrangers entrés en France avant 13 ans ou encore ceux gravement malades ne peuvent, parmi d’autres, jamais faire l’objet d’une OQTF – l’administration devant se retrancher sur l’arrêté d’expulsion si elle parvient à justifier une menace « grave » pour l’ordre public.
Le projet de loi entend désormais faire table rase de l’ensemble de ces protections (à l’exception des mineurs) au profit d’un examen global du droit au séjour de la personne.
Celui-ci serait réalisé lorsque le préfet envisage de prendre une OQTF, et tiendrait inévitablement compte de l’existence d’une menace pour l’ordre public (comme l’impose le code des étrangers à l’occasion d’une demande de titre de séjour). La commission mixte paritaire pourrait s’accorder sur une mention explicite à une telle menace pour écarter le bénéfice des protections. Quoi qu’il en soit, cet élément reste hautement dommageable en ce qu’il prévaut sur tous les autres : vie privée et familiale en France, situation professionnelle, durée de présence sur le territoire, etc. Et quand bien même le juge administratif restera en charge du contrôle de la légalité de l’OQTF, leur notification – qui a lieu le plus souvent en prison quelques jours avant la libération de l’étranger – continueront à se dérouler dans des conditions peu compatibles avec le droit au recours effectif, notamment les délais.
Vers une double peine sans peine ?
À l’arrivée, ces changements achèveraient la mutation progressive d’une mesure initialement pensée pour acter, dans des cas précis, la situation irrégulière d’un individu et permettre son éloignement, en véritable instrument discrétionnaire de répression.
Le même risque d’arbitraire se retrouve avec les conséquences tirées d’une violation des « principes de la République » qui seraient nouvellement introduits, et dont la qualification juridique des faits échapperait là encore à l’institution judiciaire (laquelle n’est déjà pas exempte de subjectivité).
Demain, l’administration pourra-t-elle, sans autre forme de procès, refuser ou retirer un titre de séjour à une personne qu’elle considère avoir bafoué les « symboles de la République » (et par suite l’expulser) ? Tout porte à le croire. Sur la base de quels critères ? De quel socle de valeurs communes ? Dit autrement, allons-nous vers une double peine sans peine ?![]()
Julien Fischmeister, Doctorant en droit, Université Grenoble-Alpes, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.