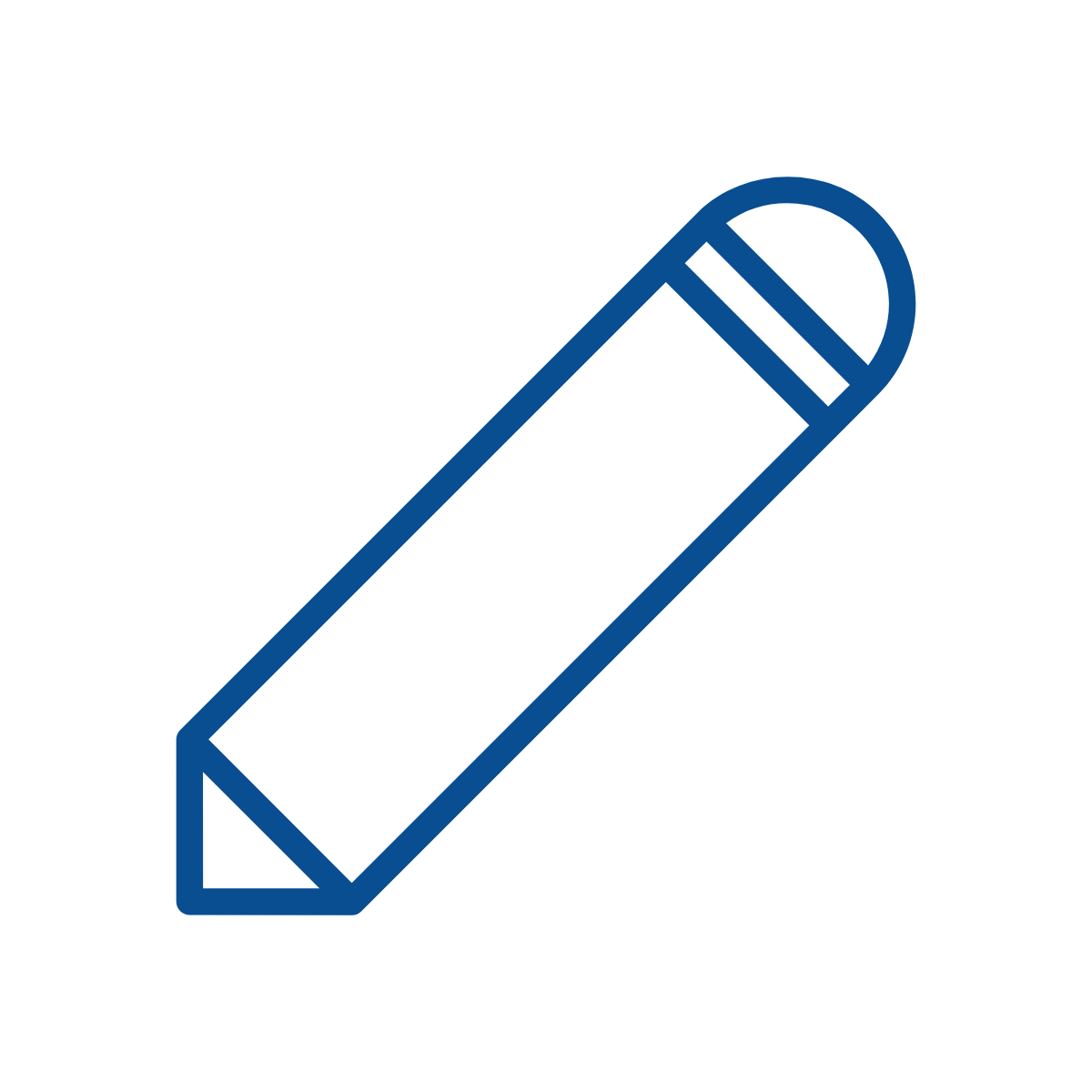Dans la même rubrique
-
Partager cette page
En mission au Groenland pour mieux comprendre l’histoire de la calotte glaciaire
Dans le cadre du projet européen Green2Ice, Mathia Sabino (Laboratoire de Glaciologie – Faculté des Sciences) a participé à une mission scientifique de dix jours au Groenland. Objectif: collecter des échantillons environnementaux pour mieux comprendre les écosystèmes et les conditions climatiques ayant précédé la formation de la calotte glaciaire.
Crédits photo : Charlotte Prud’homme
La calotte glaciaire du Groenland, dernière grande calotte de l’hémisphère Nord, subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Les scientifiques estiment que, lors de périodes plus chaudes du passé, elle a perdu une grande partie de son volume, voire disparu complètement. Mais les raisons de ces changements, ainsi que leurs conséquences environnementales, restent encore mal connues.
C’est dans ce contexte qu’a été lancée la mission Green2Ice, un projet de recherche financé par le Conseil européen de la recherche (ERC Synergy), mené par l’ULB, représentée par François Fripiat (Laboratoire de Glaciologie – Faculté des Sciences), l’université de Copenhague, le CNRS et l’Université de Lorraine. L’objectif : retracer l’histoire climatique, glaciaire et écologique du Groenland afin de mieux anticiper l’impact que pourrait avoir, dans le futur, la perte massive de glace.
En juillet dernier, Mathia Sabino, chercheur postdoctoral au Laboratoire de Glaciologie de la Faculté des Sciences, a participé à une mission de dix jours sur la marge ouest de la calotte glaciaire, près de Kangerlussuaq. Il était accompagné d'une chercheuse CNRS de l’Université de Lorraine, et de trois chercheurs de l'université Charles de Prague, partenaire du projet Green2Ice.
Après un passage par la base scientifique KISS pour préparer le terrain, l’équipe a marché 14 km à travers la toundra avec tout le matériel, pour installer un campement au front du glacier Isunnguata Sermia.
Sur place, les chercheurs ont prélevé différents échantillons : sédiments fluviaux, dépôts éoliens, sols du pergélisol, glace issue de la base du glacier ou encore sédiments subglaciaires provenant de spectaculaires sources d’eau jaillissant devant le glacier.
Ces échantillons permettront à Mathia Sabino d’analyser des molécules organiques fossiles issues d’organismes ayant vécu dans ces environnements proglaciaires. Les résultats seront ensuite comparés à ceux obtenus à partir de couches profondes de glace (glace basale) extraites lors de forages au centre et à la périphérie de la calotte glaciaire du Groenland.

Mathia Sabino en train de réaliser un prélèvement.
La comparaison de la signature moléculaire des échantillons modernes à celle des échantillons anciens offrira des indices précieux sur la composition des écosystèmes et les conditions climatiques passées. Il sera ainsi possible de mieux comprendre les environnements ayant existé avant la formation de la calotte glaciaire actuelle.
Une nouvelle mission est prévue l’an prochain pour récupérer d’autres carottes de glace et sédiments à la base de la calotte, avec l’ULB comme institution co-dirigeante.