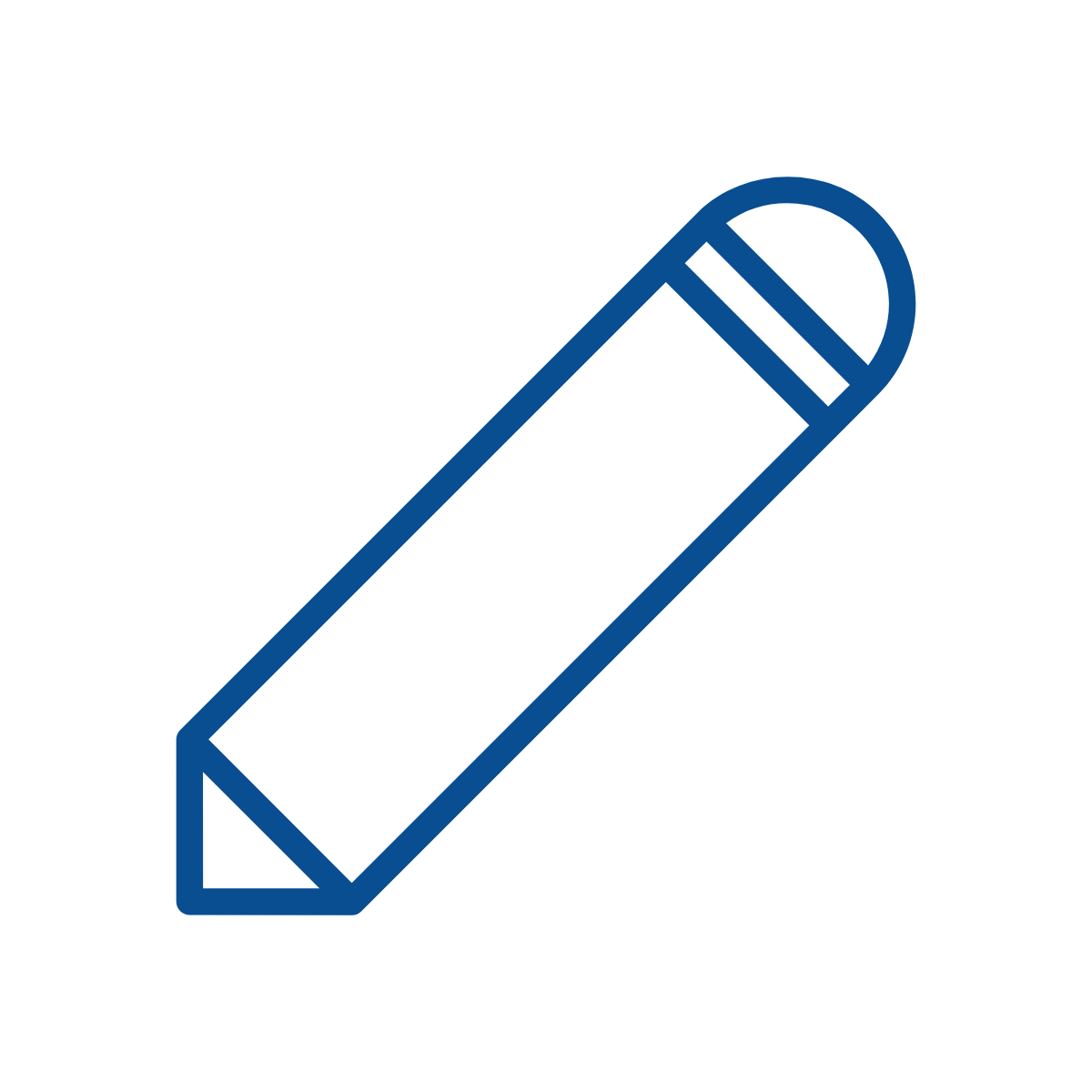Depuis cinq ans, GANGS, un projet financé par le Conseil européen de la recherche et dirigé par Dennis Rodgers, étudie les dynamiques des gangs à l’échelle mondiale. Quand on étudie le phénomène de manière nuancée, en s’affranchissant des stéréotypes et du mépris habituels, les gangs et les gangsters peuvent nous permettre de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons.
Ellen Van Damme dresse ici le portrait de Jennifer, la première cheffe de gang hondurienne, dont l’histoire illustre la nature souvent machiste et patriarcale des gangs, et les contraintes qui étaient les siennes du fait de son sexe, même en tant que cheffe de gang.
Installée dans un fauteuil en plastique, j’observe le profil de Jennifer. Elle est assise dans un petit canapé deux places sans accoudoir. Le salon est équipé d’un autre canapé, d’une télévision et, à côté, une cuisine sans table. Nous sommes en 2021 et, pour la première fois de sa vie, Jennifer, 38 ans, a une maison à elle.
Elle me dit qu’elle a de la chance d’avoir trouvé un T3 dans son budget, même si ce dernier est situé tout proche de territoires sous le contrôle de plusieurs gangs. Jennifer n’est pas très grande, mais sa posture et son air sévère lui confèrent une certaine autorité. Il fait très chaud à l’intérieur. Le ventilateur nous rafraîchit à intervalles réguliers, mais à peine. Jennifer porte une robe rose moulante. Les jambes croisées, elle me regarde, son téléphone posé à côté d’elle.
Deux ans ont passé depuis notre première rencontre, en 2019. De 2017 à 2020, je me suis documentée sur les femmes dans les gangs au Honduras dans deux grandes villes du pays. Jusqu’alors, nous ne disposions que du point de vue de chercheurs masculins. Je voulais donc proposer un regard féminin en interrogeant directement les intéressées. Jennifer était l’une d’entre elles.
Toute sa vie dans un gang
J’ai rencontré Jennifer la première fois chez une assistante sociale qui l’avait aidée quand elle a quitté le gang, en 2007, en lui trouvant un emploi dans une ONG spécialisée dans la réinsertion des repentis.
Dès le départ, Jennifer a été très claire :
Bon, si je suis là, c’est uniquement parce que vous m’avez été recommandée, mais il y a des choses dont je ne parlerai pas.
C’est la toute première chose qu’elle m’a dite.
La Jennifer qui est assise devant moi aujourd’hui est beaucoup plus détendue et parle avec beaucoup moins de précautions, car cela fait deux ans que nous nous connaissons. Elle sait que je suis là parce son parcours de vie m’intéresse et que je n’irai pas par exemple la dénoncer à la police.
Jennifer est devenue la matriarche de son foyer. C’est elle qui fait vivre ses trois enfants mais aussi son petit ami. Elle a l’air d’avoir enfin repris un peu sa vie en main.
Rêves brisés
Lors de notre entretien initial, Jennifer m’avait dit qu’elle avait besoin de se sentir aussi puissante et dominante que les hommes. Petite, elle adorait les Barbies, mais dès que ses parents se sont séparés, elle a regretté de ne pas être un garçon, pour pouvoir être l’homme de la maison. Elle a pris conscience du rôle qui lui avait été assigné à la naissance quand son beau-père a emménagé avec eux et a demandé à Jennifer et à ses frères et sœurs de lui obéir.
À 13 ans, Jennifer a été violée par son beau-père. Elle est partie de chez elle et, en moins de 24 heures, son rêve d’être une princesse Barbie s’est transformé du tout au tout. Elle alors rejoint les rangs d’un gang, la seule communauté qui voulait bien d’elle.
À l’époque, dans les années 1990, Jennifer n’a pas eu besoin de suivre un rituel pour faire partie du groupe. Mais une chose était claire dans son esprit : elle voulait apprendre à tuer, et ce pour se venger de son beau-père.
Elle a d’abord fait partie d’un petit gang urbain, actif depuis les guerres civiles et les conflits de 1960 à 1990 en Amérique centrale.
Au cours de cette période, beaucoup de gens ont fui la région et se sont installés aux États-Unis, principalement à Los Angeles et à New York.
Certains de ces migrants aux États-Unis n’ont eu d’autre option que de rejoindre les rangs de gangs latinos, comme le Barrio 18 et la Mara Salvatrucha, ou MS-13.
Mais, du fait des déportations massives de sans-papiers vers l’Amérique centrale enclenchée par l’administration américaine à la fin de la période de guerre, la culture des gangs du Barrio 18 et de Mara Salvatrucha s’est exportée, pour se développer au Salvador, au Guatemala et au Honduras.
Au Honduras, le Barrio 18 et le MS-13 ont très vite pris le contrôle des gangs locaux, étant beaucoup plus puissants et bien mieux organisés.
Jennifer, elle, n’a pas hésité : dès que le Barrio 18 et Mara Salvatrucha ont commencé à démontrer leur puissance dans le pays, elle a quitté son gang pour rejoindre cette multinationale du crime. Notons au passage que même si les gangs poursuivent leur trafic au niveau local aujourd’hui, leur contribution est insignifiante comparée à celle des cartels ou transportistas du pays.
L’arrivée dans le gang
Jennifer a été intégrée « comme un homme », en étant rouée de coups par plusieurs représentants des gangs (13 coups pour les membres du MS-13 et 18 pour ceux du Barrio 18). Comme il n’y avait quasiment aucune femme à l’époque dans ces organisations, elle a été tabassée par des hommes. En dépit de l’idée selon laquelle les femmes sont violées dans le cadre de leur rite d’initiation, Jennifer n’a eu toutefois aucune relation sexuelle (forcée ou consensuelle) à cette occasion.
Elle souhaitait gravir les échelons le plus vite possible, car elle ne voulait pas recevoir d’ordres. Elle ne voulait pas non plus être une mule et transporter la drogue, mais plutôt être celle qui supervise le trafic de marijuana.
Le rôle des femmes dans ces organisations la dérangeait, m’a-t-elle souvent confié. Les hommes estimaient en effet que les femmes étaient particulièrement utiles pour le trafic de stupéfiants à l’intérieur des prisons, en faisant passer un maximum de drogues insérées dans leur vagin et leur anus au péril de leur vie. Pour 500 à 1 000 lempiras honduriens (l’équivalent de 18 à 37 €), elles s’enfonçaient autant de sachets qu’elles le pouvaient et tentaient de ne pas se faire prendre par les gardiens.
Jennifer ne voulait pas être une subalterne anonyme et interchangeable. Elle se rêvait en cheffe.
« J’ai dû endurer beaucoup de passages à tabac pour gagner le respect d’hommes violents, des hommes couverts de tatouages sur le corps et le visage. »
Elle a fini par obtenir ce qu’elle voulait.
Une cheffe de 15 ans
Après avoir gagné le respect des hommes, Jennifer a rapidement gravi les échelons. Elle supervisait le trafic de marijuana, qui était alors la principale drogue sur le marché. Avec plus d’une douzaine de femmes sous ses ordres, elle est devenue, à 15 ans, cheffe d’une organisation criminelle.
« Comme ailleurs, les gangs n’échappent pas au machisme. Être une femme dans un gang, c’est la double peine. »
Dans les gangs comme dans l’ensemble du pays, Le machisme et la croyance en l’hégémonie masculine sur les femmes s’exercent par la violence et le contrôle, mais aussi par les féminicides.
Les taux de féminicide ont en outre augmenté au cours des deux dernières décennies au Honduras, pays qui en compte le plus en Amérique latine.
Le 4 mai 2017, Miss Honduras, Maria Jose Alvarado, est devenue le symbole tragique des violences faite aux femmes après son assassinat. De nombreuses Honduriennes vivent dans la peur d’être agressées par les hommes.
En 2021, le 911, le numéro d’urgence au Honduras, a reçu 38 988 signalements de violence domestique. En 2014, 95 % des auteurs de ces faits n’avaient pas été poursuivis.
Jennifer a donc dû lutter contre le machisme ordinaire. Les femmes du gang, même si elles n’avaient pas de relations intimes avec les hommes, étaient censées s’occuper des tâches ménagères : faire la lessive des hommes, leur préparer à manger, etc. Or Jennifer, qui avait déjà souffert du machisme violent de son beau-père, n’était nullement disposée à accepter les comportements machistes au sein du gang.
« Les meurtres ne s’arrêtaient jamais. »
Après avoir fait preuve de courage en refusant le rôle traditionnel que les hommes tentaient de lui faire jouer et en partant combattre à leurs côtés, ils ont estimé qu’elle était prête pour sa première tumba (tombe). Sa mission était de tuer un membre d’un gang rival.
Jennifer, elle, ne voulait tuer personne d’autre que son beau-père. Mais cet esprit de vengeance n’a pas été compris au sein du gang. Les hommes l’ont même empêchée de passer à l’acte car, à l’époque, les paisas, ceux qui ne faisaient pas partie d’un gang, n’étaient pas considérés comme des cibles légitimes.
Avec 31,1 meurtres pour 100 000 habitants en 2023, le Honduras détient le taux d’homicides le plus élevé d’Amérique centrale. Pourtant, ces chiffres n’ont jamais été aussi bas depuis 20 ans (le record, établi en 2011, était de 86,5 meurtres pour 100 000 habitants). Si les médias et l’opinion accusent les gangs d’en être responsables, près de 60 % des homicides sont en réalité non élucidés. Personne ne connaît les effectifs exacts des gangs au Honduras, mais on estime qu’ils regroupent aujourd’hui 5 000 à 40 000 membres actifs.
Bien que le Honduras, comme le Salvador, ait instauré l’état d’urgence pour lutter contre les gangs, la corruption et la collusion des forces de l’ordre reste endémique.
Comme elle n’était pas autorisée à tuer son beau-père, Jennifer s’est concentrée sur l’assassinat de membres de gangs rivaux qui lui étaient demandés. Après chaque meurtre, elle se cachait dans un hôtel, faisait profil bas et s’oubliait dans la drogue.
« Ça ne s’arrêtait jamais. Quand ils tuaient deux types à nous, on en tuait trois, et puis ils se revenaient se venger. C’était sans fin », soupire-t-elle.
Le recrutement des femmes
À l’époque où Jennifer prenait du galon, il a fallu recruter davantage de femmes pour compenser le nombre croissant d’hommes emprisonnés, conséquence de la politique de la Mano Dura (« Poigne de fer) ». Cette politique répressive mise en œuvre en Amérique centrale au début des années 2000 pour tenter d’entraver la violence des gangs s’accompagnait de réformes du code pénal qui permettaient aux forces de l’ordre d’arrêter et d’incarcérer toute personne (principalement des jeunes hommes) soupçonnée d’être membre d’un gang du simple fait de sa tenue ou de son apparence (vêtements amples, tatouages, etc.).
Cette politique n’a cependant pas eu les effets escomptés, puisque les gangs se sont mis à recruter encore plus de membres, y compris des femmes et de jeunes enfants, ce qui a fait exploser le nombre d’homicides.
Quand elle faisait partie du gang, Jennifer n’avait plus de contact avec sa famille. Si les hommes maintiennent la plupart du temps des liens avec leur famille biologique et reçoivent la visite de leur mère, de leur épouse ou d’autres membres de leur famille notamment en prison, ce n’est pas le cas des femmes, qui deviennent des parias en raison de ce qui est considéré comme une « double déviance », vis-à-vis de la loi et du rôle qui leur est traditionnellement assigné par la société.
Les nouvelles recrues féminines ont commencé par introduire clandestinement de la drogue et des armes en prison, mais elles ont rapidement été chargées de voler des armes, de se livrer au trafic de drogue ou à l’extorsion de fonds, et de tuer.
Au cours d’une des nombreuses fusillades entre la police et sa bande pour tenter d’empêcher l’arrestation d’une de ses « filles », Jennifer a été interpellée et incarcérée. En prison, elle a découvert que son beau-père continuait de battre sa mère et qu’il lui avait même porté des coups de couteau. La colère de Jennifer était décuplée, mais elle était impuissante tant qu’elle était incarcérée.
Mise en retrait
Après les meurtres et violences qu’elle avait commis au sein du gang, les viols qu’elle avait subis en prison de la part des policiers, et après avoir perdu son statut de cheffe du fait de son incarcération, Jennifer a décidé qu’elle voulait changer de vie.
Quand elle a accouché en prison de son premier fils, elle a imploré les chefs du gang de la laisser partir. Elle connaissait les risques. Beaucoup de femmes ont été tuées parce que les hommes du gang estimaient qu’elles les avaient trompés, et un très petit nombre d’entre elles – celles qui avaient la pleine confiance des chefs – étaient autorisées à se mettre en retrait. Car, comme l’explique Jennifer, « on ne quitte jamais vraiment un gang ».
Après plusieurs mois de plaidoyer auprès des chefs, elle a reçu la permission tant attendue de quitter le gang en 2007. Elle dit depuis qu’elle a « troqué son arme contre une Bible ».
Le beau-père de Jennifer a finalement été condamné à une peine de prison pour avoir violé et mutilé une fille de 13 ans, commis plusieurs féminicides, et tenté de tuer la mère de Jennifer.
Son corps sera toujours identifié au gang
Jennifer, du haut de ses 38 ans aujourd’hui, et comme la plupart des femmes que j’ai rencontrées au cours de mes recherches, a connu beaucoup de hauts et de bas depuis sa sortie du gang. Elle a systématiquement du mal à joindre les deux bouts et a dû résister aux tentatives du gang de la récupérer en lui promettant beaucoup d’argent si elle reprenait ses activités de trafic de drogue.
À l’époque où elle participait à un programme de réinsertion sociale, elle a fait une rechute dans la drogue et l’alcool. Elle a été radiée, ce qui est catastrophique dans la mesure où il n’existe pratiquement aucun programme de réhabilitation ni de réintégration au Honduras pour les femmes qui quittent les gangs.
Elle me dit toutefois fièrement qu’elle est “clean” depuis sept ans. Mais sa plus grande inquiétude, c’est que ses fils soient recrutés dans un gang quand ils grandiront.
Au début de 2024, Jennifer m’a envoyé un texto pour me dire que la situation empirait (j’ai compris qu’elle faisait référence à demi-mot à la présence croissante des gangs dans son quartier) et qu’elle envisageait de quitter le pays avec ses deux plus jeunes fils.
Aux États-Unis, le nombre d’immigrants en provenance d’Amérique centrale augmente de manière exponentielle depuis quarante ans : il est passé de 354 000 en 1980 à 3 820 000 en 2021. Le Salvador (1 418 000), le Guatemala (1 107 000) et le Honduras (768 000) forment le gros du contingent, dont la motivation principale est de fuir la violence des gangs, une violence souvent qualifiée de véritable guerre.
Quand je l’avais rencontrée 3 ans plus tôt, on devinait sur son bras un tatouage qui dépassait de sa robe à manches courtes. Lors de sa mise en retrait, elle avait obtenu la permission de dissimuler certains des tatouages liés au gang, sauf ceux qui mentionnaient explicitement son nom. Car, quoi qu’il arrive, son corps restera toujours lié au gang. Et, ce jusqu’à sa mort.
Traduit de l’anglais par Fast ForWord![]()
Ellen Van Damme, Chercheuse, Post-doctorante, Centre de Recherches en Droit Pénal (CRDP), Université Libre de Bruxelles (ULB)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.