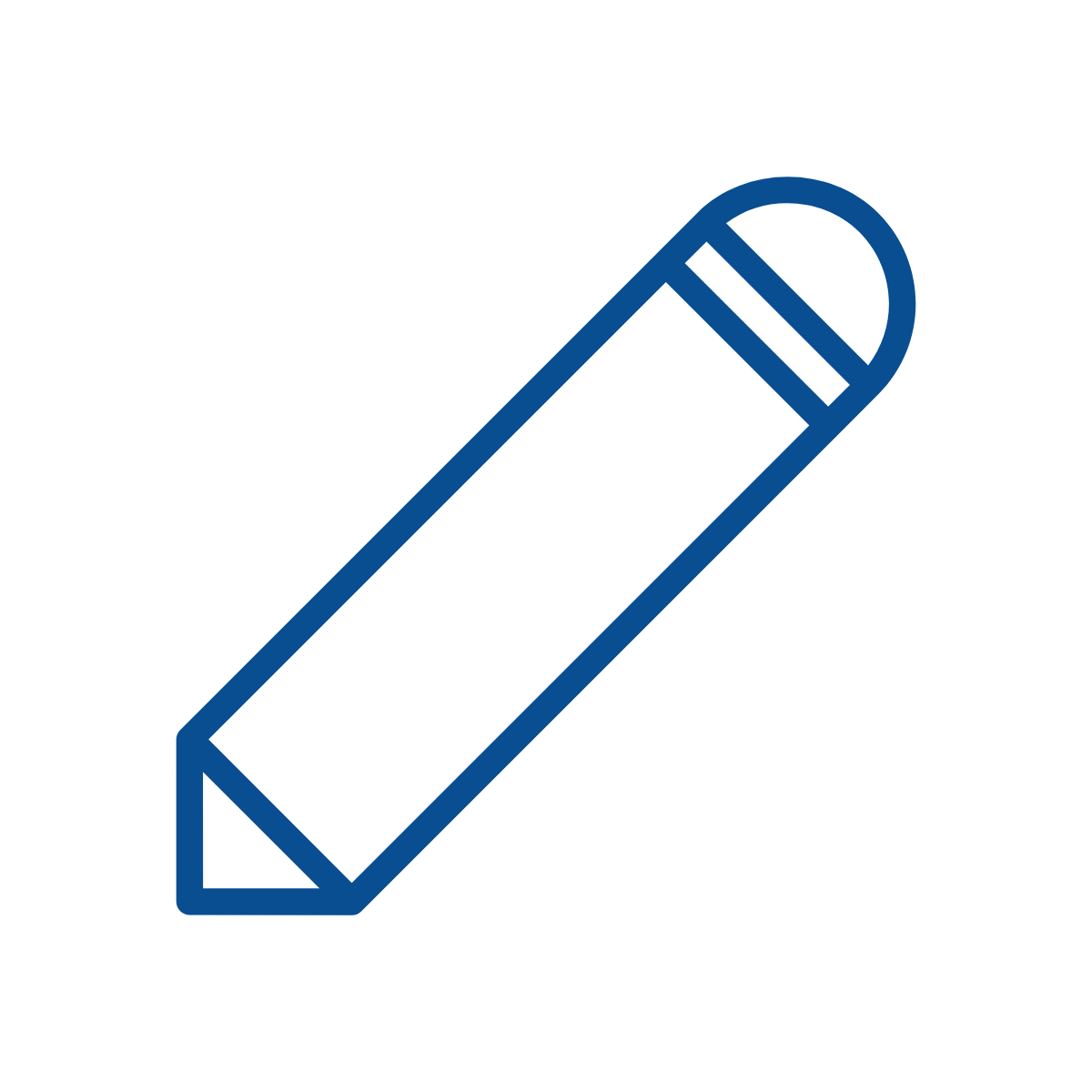Dans la même rubrique
- Actus & Agenda
- FR
- Grand angle
-
Partager cette page
Comprendre les mobilités sociales dans l’Afrique d’aujourd’hui
Interpréter les formes et les contours des mobilités sociales auxquelles peuvent prétendre les jeunesses africaines requiert de comprendre les sociétés du continent comme des espaces sociaux structurés par différents systèmes d’inégalité entrelacés. Un article de Joël Noret, Université Libre de Bruxelles (ULB), Département des Sciences sociales et des Sciences du Travail, dans The Conversation.
Joël Noret, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Dans une époque de montée des inégalités, rendre compte des formes de mobilité sociale est un enjeu crucial pour les sociétés contemporaines.
En Afrique, les sociétés sont aujourd’hui largement marquées à la fois par leur jeunesse et par de hauts niveaux d’inégalité. À travers le continent, les frustrations sociales et économiques de la jeunesse sont d’ailleurs régulièrement pointées comme des ressorts importants des dynamiques sociopolitiques, qu’il s’agisse de mouvements sociaux, de soulèvements populaires ou du soutien des citoyens à des coups d’État.
Or, interpréter les formes et les contours des mobilités sociales auxquelles peuvent prétendre les jeunesses africaines requiert de comprendre les sociétés du continent comme des espaces sociaux structurés par différents systèmes d’inégalité entrelacés.
Les écarts de condition au sein d’une jeunesse plurielle sont évidemment ancrés dans des inégalités de ressources économiques, mais aussi culturelles et sociales. Ces inégalités se trouvent également imbriquées à d’autres qualités des individus, comme leur identité de genre, division majeure ici comme ailleurs des espaces sociaux, ou leur identité régionale – on sait la saillance dans nombre de contextes africains du fait ethno-régional.
Inévitablement entremêlées, ces différentes ressources et qualités sociales structurent ou conditionnent ce qu’on peut désigner comme les « chances de vie », selon la formule de Max Weber, c’est-à-dire les opportunités d’accéder aux biens et aux formes de vie désirables dans une société donnée.
Des espaces sociaux en mouvement
Une première difficulté pour penser les mobilités sociales africaines découle du fait que les sociétés du continent se transforment aujourd’hui rapidement. Ainsi, certaines formes de mobilité intergénérationnelle ne font qu’accompagner des transformations plus globales.
Par exemple, l’élévation du niveau d’instruction d’une génération à l’autre, régulièrement constatée à travers le continent, n’est pas nécessairement synonyme de trajectoires familiales ascendantes. Elle doit être contextualisée par rapport à l’élévation générale du niveau d’éducation sur le continent. Avoir obtenu le bac ou son équivalent dans les années 1970 ou dans les années 2020 n’a pas la même signification sociale et ne se traduit pas de la même manière en niveau et en style de vie. Certaines trajectoires pouvant d’abord apparaître comme des formes de reproduction sociale ne le sont donc qu’en partie.
On retrouve un phénomène analogue dans la situation de bien des jeunes paysans africains. En effet, ceux-ci s’engagent aujourd’hui dans l’agriculture dans des sociétés globalement marquées par un exode rural et un déclassement social des paysans. Une telle dynamique est observable à travers le continent depuis plusieurs décennies. Elle affecte désormais fondamentalement la valeur sociale et la signification de la condition paysanne : sous la reproduction peut se loger une forme de déclassement.
Comprendre les mobilités sociales contemporaines demande donc de s’interroger à la fois sur l’évolution des conditions d’existence et des styles de vie, mais aussi sur leur signification et sur les formes de reconnaissance sociale qui peuvent être ou non attachées aux positions sociales – d’où la notion d’im/mobilités sociales, proposée pour évoquer de telles dynamiques paradoxales où s’entremêlent reproduction et mobilité sociales.
Des mobilités « latérales » ou « transversales »
Au Bénin, bon nombre de conducteurs de « taxis-motos » sont issus de milieux ruraux, et évoluent entre ville et campagne, retournant à intervalles réguliers vers leur village d’origine, où sont restés vivre femme(s) et enfants. Partageant souvent à plusieurs des logements exigus et pour le moins sommaires lors de leurs séjours en ville, ils maximisent ainsi leurs possibilités d’épargne et d’investissement dans leurs projets d’avenir.
D’autres jeunes ruraux, moins nombreux qu’en ville à achever leur scolarité, tenteront eux aussi l’aventure urbaine, et se feront ouvriers, ou encore revendeurs de bien achetés à crédit, en espérant voir leurs affaires progresser peu à peu.
Ainsi, de nombreux hommes et femmes s’affranchissent progressivement de la condition paysanne, et passent d’une situation de pauvreté rurale aux quartiers populaires d’une grande ville du continent. Là, certains parviendront certes à s’élever dans l’espace social en mettant à profit une compétence professionnelle reconnue. Mais pour une nette majorité, ce seront les petits commerces ou les emplois peu qualifiés du précariat urbain, dans l’incertitude de l’économie dite « informelle », ou dans les nouvelles « zones économiques spéciales » au cœur des stratégies d’industrialisation du continent.
De tels déplacements dans l’espace social ne peuvent pas toujours être réduits à des « gains » ou à des « pertes » sur une échelle sociale unidimensionnelle. Ils gagnent plutôt à être appréhendés comme des déplacements « latéraux » entre milieux populaires, ruraux et urbains, ou « transversaux », lorsqu’ils s’accompagnent d’une légère ascension sociale.
En effet, la croissance urbaine et la réduction de la part de la population active dans l’agriculture, attestée à travers le continent au-delà de la diversité des situations nationales, correspondent évidemment à une dynamique sociale majeure, dont les implications culturelles vont bien au-delà de la structure professionnelle, car l’urbanisation affecte en profondeur les styles de vie.
Pour autant, si l’on considère la mobilité sociale comme une altération des « chances de vie », lorsque des individus peu scolarisés issus des campagnes rejoignent les couches pauvres de la société (péri-) urbaine, cela ne modifie pas fondamentalement leurs conditions d’existence, ni leurs « chances » d’accumuler des richesses ou d’accéder à des revenus suffisants.
Les exemples de ce type de situation abondent. À Kinshasa, les salariés précaires de l’économie informelle vivent de maigres revenus et souvent dans des conditions de grande précarité qui s’avèrent au final peu différentes de celles des milieux ruraux qu’ils ont parfois quittés pour tenter leur chance en ville.
L’accès à la ville demande par ailleurs bien souvent de mobiliser des relations familiales plus ou moins éloignées, qui fourniront le point de départ d’un réseau de relations à reconstruire : ressources économiques et « capital social » sont souvent étroitement imbriqués dans les trajectoires de mobilité sociale entre ville et campagne.
Mais au final, les classes populaires urbaines sont exposées dans bien des cas à des formes comparables d’incertitude sur leur destin social que leurs équivalents ruraux. Ainsi, bien des mobilités sociales dans les régions inférieures de l’espace social sont en fait des déplacements courts, plus ou moins « latéraux », qui voient les individus changer de secteur d’activité et d’environnement, sans que ne soient fondamentalement affectées leurs « chances de vie ».
L’éducation en question
Au cœur de bien des trajectoires sociales ascendantes – surtout masculines – dans la deuxième partie du XXe siècle, l’éducation est toujours aujourd’hui susceptible de produire des effets de mobilité sociale ascendante, quoique de manière moins immédiate qu’il y a quelques décennies.
Au Niger et en République démocratique du Congo, parmi d’autres exemples possibles, l’accès à l’emploi salarié privé ou public se fait difficilement sans faire jouer des relations : valoriser les titres scolaires demande aussi un certain capital social.
Dans les exploitations agricoles du nord de l’Afrique du Sud, de jeunes diplômés universitaires zimbabwéens cueillent des fruits aux côtés de migrants plus anciens, établis sur place et travailleurs permanents des mêmes exploitations. Leurs titres universitaires ne semblent pas leur avoir permis une insertion professionnelle stable dans la société zimbabwéenne, et leur trajectoire sociale à venir reste indécise.
Pour autant, l’éducation reste massivement investie à travers le continent. Et le niveau des titres scolaires et universitaires s’élève régulièrement au fil du temps dans toutes les couches moyennes de la population, ces fameuses « classes moyennes » africaines dont l’avènement est célébré par les institutions internationales, mais dont l’hétérogénéité reste considérable, et les contours incertains.
Ceci dit, différents travaux, menés en Afrique de l’Ouest ou centrale, ont montré que la possession de titres scolaires, et plus encore universitaires, restait un vecteur de stratification sociale important à travers le continent. Mais le lien entre éducation et mobilité sociale ascendante semble bien s’être distendu. Pour le dire autrement, l’éducation n’est plus un ascenseur social aussi puissant aujourd’hui que dans les décennies ayant suivi les indépendances.
En outre, le développement massif, au cours des dernières décennies, d’un secteur éducatif privé a peu à peu introduit une stratification économique de l’offre d’enseignement, les écoles privées proposant souvent une formation davantage prisée des couches moyennes et supérieures de la population.
Au niveau universitaire, le coût des formations publiques a progressivement augmenté parallèlement au développement de l’offre privée. De nouvelles barrières économiques à l’accès à l’enseignement supérieur ont été introduites. Ainsi, les étudiants aux origines modestes ou issus du monde rural font désormais face non seulement à une distance culturelle avec l’enseignement supérieur, mais aussi à des obstacles économiques à la poursuite de leurs études.
Des mobilités complexes
La figure de l’entrepreneur s’étant fait « tout seul » hante les discours sur la mobilité sociale, en Afrique et au-delà. Pour autant, si les ascensions sociales fulgurantes existent bel et bien, la plupart des mobilités dans l’espace des positions sociales sont des déplacements courts, façonnés par les différentes ressources, économiques et sociales, que des individus aux conditions d’existence très différentes, peuvent assembler.
Du Niger et du Nigeria à l’Ouganda, la République démocratique du Congo et l’Afrique du Sud, les recherches réunies dans le volume Social Im/mobilities in Africa que j’ai eu l’occasion de diriger documentent pour l’essentiel des trajectoires de mobilité sociale incertaines et instables, qui ne subvertissent que rarement les écarts de condition et de statut importants qui impriment aujourd’hui leur marque sur la dynamique des sociétés africaines.![]()
Joël Noret, Professeur d'anthropologie, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.