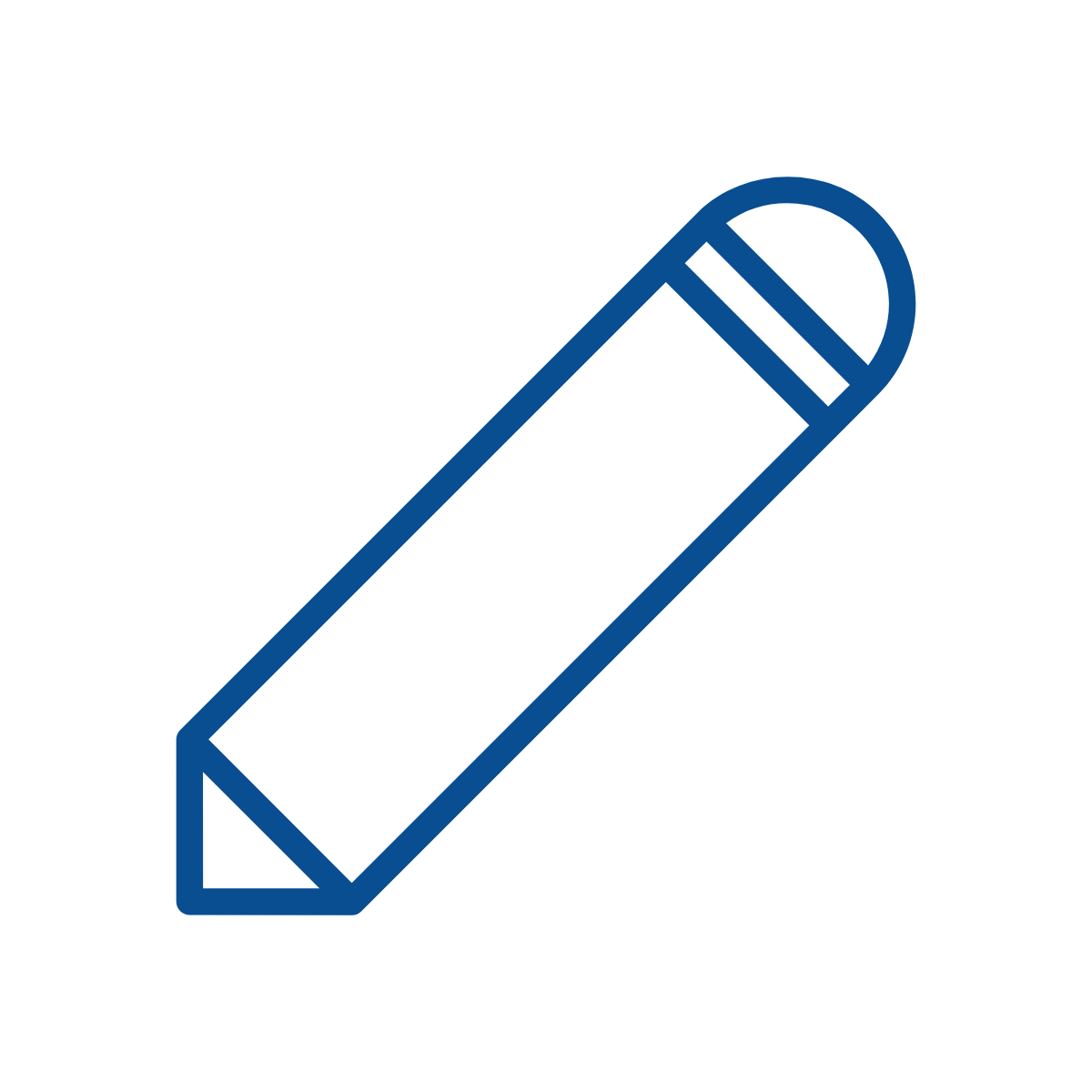Dans la même rubrique
- Actus & Agenda
- FR
- Grand angle
-
Partager cette page
Trois raisons de ne pas qualifier l’extrême droite de populiste
Le terme populisme fait partie des plus entendus et des plus galvaudés de ces dernières années. Employé à tort et à travers tant dans la presse politique que dans la littérature académique, il qualifie – le plus souvent de façon péjorative – toutes sortes de partis et figures politiques qui n’ont pourtant rien à voir les uns avec les autres. Une analyse de Jean-Yves Pranchère, Département de Science politique (ULB) dans The Conversation.
Pierre-Etienne Vandamme, KU Leuven; Arthur Borriello, Université de Namur et Jean-Yves Pranchère, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Le terme populisme fait partie des plus entendus et des plus galvaudés de ces dernières années. Employé à tort et à travers tant dans la presse politique que dans la littérature académique, il qualifie – le plus souvent de façon péjorative – toutes sortes de partis et figures politiques qui n’ont pourtant rien à voir les uns avec les autres. On dit que Donald Trump est populiste alors que c’est Barack Obama qui se revendique de la tradition populiste américaine. On le dit de Javier Milei alors qu’il a précisément fait campagne contre le populisme argentin incarné par le péronisme. Mais sait-on seulement ce que représente, historiquement, le populisme ?
Des origines démocrates et anti-oligarchiques
Le premier mouvement à se revendiquer populiste émergea aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Loin des clichés contemporains sur l’anti-pluralisme fondamental du populisme, il s’agissait d’un mouvement défendant la démocratie et les garanties constitutionnelles de la liberté contre les dérives oligarchiques du pouvoir en place. Certains de ses membres partageaient les préjugés racistes du Parti républicain et du Parti démocrate d’alors, mais l’orientation générale du mouvement était sociale et démocratique et il comportait – au contraire des autres partis – un nombre significatif d’afro-américains. Le People’s Party (Parti du peuple) qui émergea de ce mouvement essentiellement paysan finit par être absorbé par le Parti socialiste américain et par le Parti démocrate.
Pratiquement au même moment apparurent, en Russie, les narodniki, un mouvement d’intellectuels démocrates et socialistes qui entendaient prêter leur voix à la paysannerie opprimée et s’opposer au Tsar. Dans ce mouvement, comme chez les populistes américains, on ne trouve ni anti-pluralisme, ni leader charismatique, ni opposition aux institutions représentatives. Plutôt une forme d’anti-oligarchisme au nom du peuple et de la démocratie. Ce mouvement finira par se diviser entre une aile libérale et une aile socialiste qui, après s’être convertie au marxisme, fonda la social-démocratie russe. Les deux ailes restèrent attachées aux libertés démocratiques.
Les dérives d’un concept
Alors comment se fait-il que le terme populiste, revendiqué par ces deux mouvements, ait pu dériver au point de qualifier aujourd’hui tout ce qu’ils auraient rejeté – notamment l’autoritarisme oligarchique de Donald Trump et de Vladimir Poutine, ces nouveaux Tsars ?
La distance historique et le manque de documentation ont peut-être joué un rôle dans le cas du populisme russe, mais certainement pas dans le cas du populisme américain, qui est très bien documenté. Nous avons donc développé trois hypothèses explicatives.
Un premier moment de la dérive sémantique fut la réinterprétation du populisme américain par plusieurs politistes, dans les années 1950, comme la préfiguration du maccarthysme ou même du fascisme. Ces réinterprétations ont depuis été remises en cause par les historiens, qui soulignent aujourd’hui le caractère profondément démocratique du populisme américain, qui visait à renforcer la démocratie représentative et non à l’affaiblir.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Une deuxième étape, plus décisive, fut l’application du terme populisme à des régimes latino-américains – principalement le péronisme en Argentine – par des auteurs comme le sociologue Gino Germani. Le terme a été appliqué de l’extérieur, car ces régimes, contrairement aux exemples américain et russe, ne se qualifiaient pas eux-mêmes de populistes. En qualifiant le péronisme de « national-populiste », Germani voulait marquer la différence entre le péronisme et des formes de nationalisme qui n’avaient pas sa dimension sociale-égalitaire (à côté de sa dimension autoritaire). Mais le résultat est que le mot populisme fut associé de ce fait aux autres caractéristiques du péronisme (ses aspects nationaliste et autoritaire) qu’il ne visait pourtant pas à désigner.
Un troisième moment, d’une plus grande ampleur politique, a été celui des années 1980. En France, en Italie et en Autriche tout d’abord, les partis d’extrême droite ont remporté leurs premiers grands succès électoraux sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale et ont donc commencé à rechercher une forme de normalisation et de respectabilité. Ces partis ont stratégiquement adopté un langage démocratique et ont donc renoncé à formuler leur nationalisme xénophobe en termes d’opposition à la démocratie parlementaire. Cela a conduit un grand nombre de commentateurs politiques à parler à leur égard de « populisme », ce qui était à bien des égards une erreur de dénomination. L’extrême droite s’est alors joyeusement emparée du terme pour mieux se légitimer comme démocratique et pour séduire la classe ouvrière. En effet, quel parti à la recherche de succès électoral refuserait d’être présenté comme défenseur du peuple ? À l’heure actuelle, de nombreuses figures de l’extrême droite internationale (Viktor Orban, Steve Bannon, Eric Zemmour) se revendiquent « populistes », entendant ainsi se montrer plus démocratiques que leurs détracteurs qui, en utilisant le terme comme arme de stigmatisation, montrent leur mépris du peuple et leur adhésion à un idéal élitiste ou technocratique incompatible avec la démocratie.
Éviter le contresens
On pourrait en conclure que le terme a désormais changé de sens et que c’est l’usage contemporain qui doit prédominer. Nous pensons néanmoins qu’il y a de bonnes raisons d’éviter de s’aligner sur l’usage aujourd’hui dominant.
La première, c’est que quand un concept est trop large, désigne trop de choses différentes, il n’est plus très utile. C’est le cas du concept de populisme tel qu’il est aujourd’hui utilisé. S’il désigne à la fois un mouvement égalitariste et ancré à gauche comme Podemos en Espagne et son opposé politique – un autoritarisme xénophobe et favorable aux plus riches, comme Donald Trump – il n’est plus d’aucune aide. Car le seul point commun entre les deux est un vague appel au peuple qui est en fait un trait commun de la plupart des mouvements qui cherchent un soutien électoral, et un discours anti-establishment que tiennent pratiquement tous les partis d’opposition qui veulent remplacer les partis au pouvoir.
La seconde, c’est qu’en s’alignant sur l’usage contemporain dominant, on en arrive à des conclusions historiquement absurdes, comme lorsque le politologue Jan-Werner Müller doit affirmer que le mouvement populiste américain n’était pas populiste, pour préserver la définition qu’il utilise. Ou comme lorsqu’on désigne Donald Trump comme l’héritier du populisme alors que c’est Bernie Sanders (mieux qu’Obama) qui incarne la continuité avec le populisme historique.
La troisième raison c’est qu’on fait le jeu de l’extrême droite en l’affublant d’un terme qui lui offre un pedigree démocratique et une légitimité populaire, dissimulant ce faisant ses tendances profondément autoritaires et sa grande complaisance à l’égard des plus fortunés, à rebours de l’anti-oligarchisme démocratique des populismes historiques.
Retrouver le populisme sans l’idéaliser
Contre cet usage dominant, nous suggérons de préserver le terme populiste pour qualifier des mouvements politiques qui ont un agenda égalitaire ou démocratique, entendent défendre les classes les plus défavorisées contre des captations oligarchiques de la démocratie, et qui plutôt que de s’appuyer sur une idéologie bien définie comme le socialisme par exemple, en appellent au sens commun démocratique.
Reposant sur une idéologie très fine, le populisme peut prendre différentes formes. Il n’offre en effet pas une vision claire de ce que serait une société juste ou une démocratie idéale. Selon les contextes dans lesquels ils émergent, les mouvements populistes peuvent donc entretenir différents types de rapports aux institutions politiques. Dans des systèmes politiques sclérosés où les partis politiques sont déconnectés de leurs électeurs, les populistes sont très susceptibles de dénoncer les institutions représentatives existantes, mais plus par attachement à la démocratie populaire que par anti-pluralisme.
Le populisme bien défini n’est donc pas une menace pour la démocratie – mais cela ne veut pas dire non plus que ce soit nécessairement la solution la plus prometteuse ! En particulier, dans le contexte européen contemporain, où la crise de la démocratie représentative se marque dans le déclin des corps intermédiaires (partis et syndicats) qui assuraient le lien continu entre les groupes sociaux et l’État, la difficulté des mouvements populistes à reconstruire ces canaux de médiation de façon durable constitue un écueil fondamental du point de vue démocratique.![]()
Pierre-Etienne Vandamme, Chercheur en théorie politique, KU Leuven; Arthur Borriello, Professor, Université de Namur et Jean-Yves Pranchère, Professeur, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.