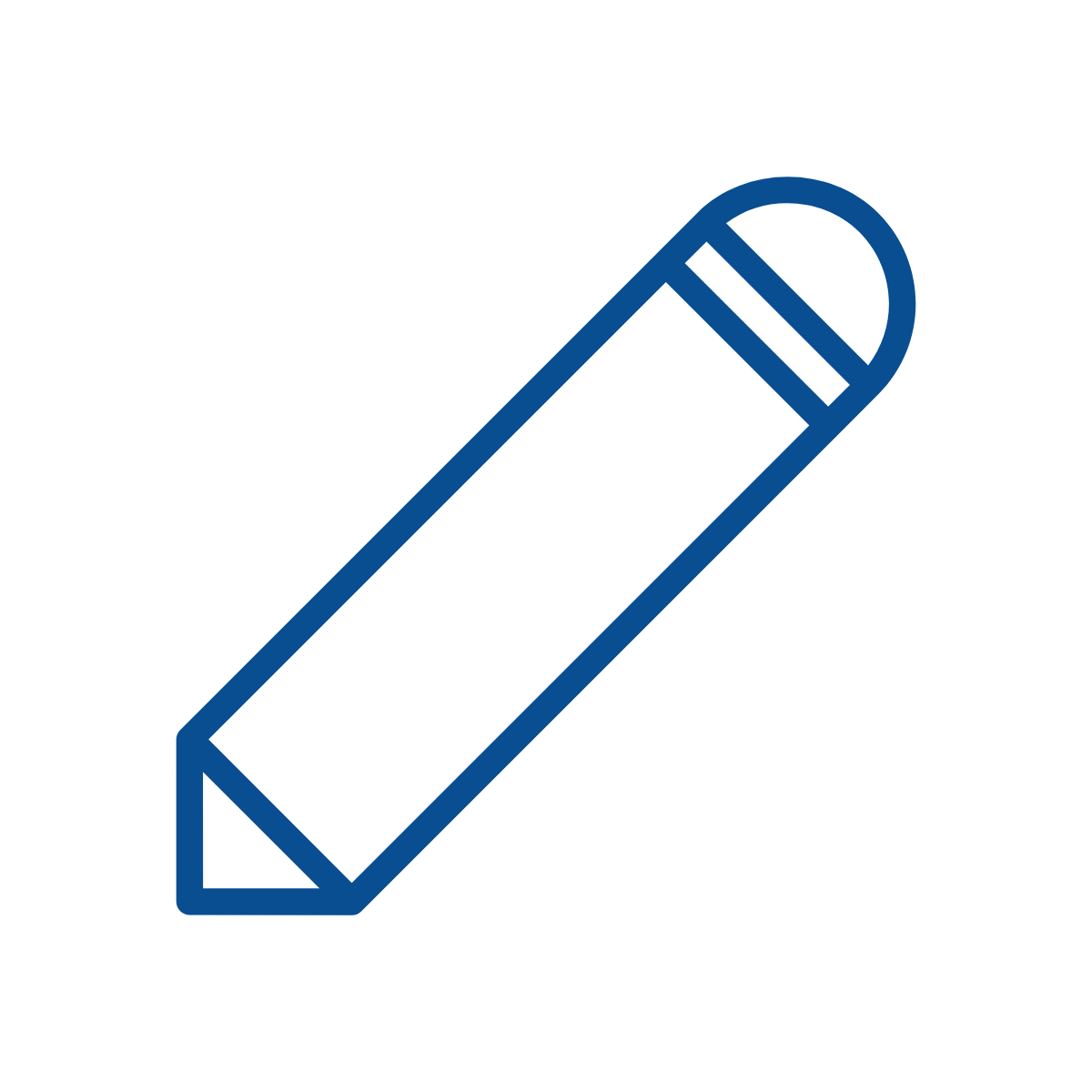Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Les politiques climatiques: entre techno-optimisme et déni de réalité
En 2015, 195 pays adoptaient l’accord de Paris et s’engageaient à limiter, avant la fin du siècle, le réchauffement climatique entre +1,5 °C et +2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. La COP21 marquait donc une avancée historique dans la lutte contre les effets catastrophiques induits par le changement climatique. Or, une majorité de scientifiques juge déjà ces objectifs inatteignables. Un article de Eric Muraille de la Faculté des Sciences dans The Conversation.
Eric Muraille, Université Libre de Bruxelles (ULB); Julien Pillot, INSEEC Grande École et Philippe Naccache, INSEEC Grande École
Le sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que le respect du seuil de +1,5 °C exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 43 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici 2035 avant d’atteindre des émissions nettes nulles pour 2050. Pourtant, les Contributions déterminées au niveau national (CDN) prévues dans l’accord de Paris ne prévoient qu’une baisse de 2 % des émissions d’ici 2030. Ce qui place notre planète sur une trajectoire de réchauffement de +2,7 °C au cours de ce siècle.
Notre incapacité à imposer une régulation contraignante sur l’extraction des combustibles fossiles, responsables de 90 % des émissions mondiales de CO2 et d’un tiers de celles de méthane, illustre à elle seule notre échec de gouvernance. En 2023, un total de 425 projets d’extraction de combustibles fossiles capables chacun d’émettre > 1 Gt de CO2 ont été recensés. Si l’on additionne les émissions de ces projets, celles-ci dépassent déjà d’un facteur deux le budget carbone permettant de rester sous les +1,5 °C.
Une stratégie techno-optimiste…
Lors de la COP28 qui s’est tenue fin 2023 à Dubaï, la sortie des énergies carbonées aurait donc dû constituer la priorité absolue. C’est pourtant une tout autre stratégie qui a été défendue par le président, le Sultan Ahmed Al-Jaber, et qui s’est imposée au terme de débats houleux.
Dans sa Lettre aux parties ainsi que dans ses interventions publiques, Al-Jaber a clairement exposé des ambitions très éloignées des objectifs de sobriété énergétique :
« Montrez-moi la feuille de route d’une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique, sans renvoyer le monde à l’âge des cavernes. »
Il évoque d’ailleurs explicitement une « économie de guerre », c’est-à-dire un engagement total des États à financer massivement le développement des infrastructures industrielles nécessaires à la production et à l’usage d’énergies renouvelables ainsi que de projets de captation et de stockage du carbone.
Aux yeux des entreprises et des décideurs politiques, cette stratégie est particulièrement attractive car elle :
-
n’exige aucune sobriété des populations ;
-
assure une forte croissance économique associée à des promesses d’emplois ;
-
ne pose aucune contrainte sur l’exploitation des énergies fossiles au plus grand bonheur des pays producteurs de pétrole qui en avaient fait une ligne infranchissable ;
-
évite tout dirigisme étatique en déléguant la gouvernance au marché.
… à l’épreuve du principe de réalité
Or, d’aucuns pourraient légitimement douter du réalisme de ce scénario techno-optimiste. La possibilité d’une « transition énergétique » reste, en effet, à démontrer puisque nous n’avons qu’ajouté de nouvelles sources énergétiques à celles que nous exploitons depuis les débuts de l’ère industrielle. Après 70 ans de développement, le nucléaire ne couvre actuellement que 3,7 % de la consommation mondiale d’énergie. Le charbon, le pétrole et le gaz en représentent toujours respectivement 25,1 %, 29,6 % et 22 %.
La transition par l’électrification de la société pose aussi de nombreuses questions, que le véhicule électrique illustre parfaitement. Une voiture électrique nécessite près de 4 fois plus de métaux qu’une voiture conventionnelle, dont une grande quantité de métaux définis par l’Union européenne (UE) comme « critiques » du fait de leur rareté ou de leur importance stratégique. Des métaux dont l’extraction pose de graves problèmes sociaux et écologiques dans les pays du Sud.
Le « dopage métallique » nécessaire à la fabrication de ces véhicules nous amène à une première impasse, dans la mesure où, à technologie constante, les réserves connues de plusieurs métaux, comme le cuivre, seront quasi épuisées dès 2050. Sans même parler des conflits d’usage, et de l’inflation qui en découlera fatalement, puisque les mêmes métaux sont nécessaires à la fabrication d’autres biens électroniques ainsi qu’à l’éolien et au solaire. Il y aura donc inévitablement une intense compétition pour l’acquisition de ces métaux, ce qui devrait favoriser les pays les plus riches. En pratique, la stratégie d’une transition massive au véhicule électrique conduira vraisemblablement à émettre du CO2 et à polluer les eaux et les sols des pays extracteurs avec pour seul bénéfice de réduire la pollution locale des métropoles occidentales.
Ajoutons à ce tableau les problèmes liés à notre dépendance aux pays producteurs de métaux et à leurs raffinages (notamment la Chine qui maitriserait 40 % de la chaine de valeur des métaux utilisés dans les batteries électriques), à la production et au stockage à grande échelle d’énergie décarbonée pour alimenter les véhicules électriques ou encore les incertitudes quant à la recyclabilité de certains composants polluants issus des batteries, et d’aucuns pourraient légitimement interroger le bien-fondé des multiples subventions sur l’offre et la demande décidées par nos dirigeants pour forcer la transition du thermique à l’électrique.
La chimère de la captation carbone
L’autre problème posé par le scénario de la COP28 réside dans la place centrale accordée à la captation et la séquestration du CO2 (CSC). Si ces techniques sont bien présentées par le GIEC comme des options d’atténuation essentielles, elles ne peuvent constituer le cœur des politiques climatiques. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) fixe ainsi le niveau de captage du carbone par les CSC à seulement 15 % des efforts de réduction des émissions si on souhaite atteindre la neutralité du secteur de l’énergie en 2070.
Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, actuellement les CSC auraient plutôt tendance à augmenter les émissions de CO2. Historiquement, ces technologies ont été développées par les pétroliers dans les années 1970 à la suite du constat que l’injection de CO2 à haute pression dans des puits de pétrole vieillissants forçait le brut résiduel à remonter à la surface. Ainsi, la plupart des installations de CSC en activité dans le monde utilisent le CO2 qu’elles captent (le plus souvent depuis des gisements souterrains) pour extraire… davantage de pétrole.
Faire subventionner ces projets de CSC par les États revient donc à leur faire financer indirectement l’extraction de pétrole. Et s’il existe bien des usines de captation de CO2 atmosphérique, la technologie du Direct Air Capture reste loin de la maturité. La plus grande usine au monde de ce type stocke 4 000 tonnes de CO2 par an, soit environ 0,001 % des émissions annuelles mondiales. Une goutte d’eau dans l’océan.
L’Agence internationale de l’énergie prévoit que, d’ici 2030, la capacité annuelle mondiale de capture du carbone pourrait s’élever à 125 millions de tonnes, soit < 0,5 % des émissions mondiales actuelles. Très loin de l’objectif d’une réduction de 43 % d’ici 2030. Ainsi, les projets de CSC actuels, bien que très coûteux, ne constituent qu’une infime fraction de ce qui serait nécessaire pour ralentir le changement climatique.
La légitimité des gouvernements en question
Comme indiqué en amont, le scénario « business as usual » établi par le GIEC nous mène vers un monde à +2,7 °C en 2100. Mais où nous mènera l’« économie de guerre » prônée par la COP28 si elle augmente la consommation d’énergie, tout en échouant à réduire significativement les émissions de CO2 via la transition énergétique et les projets de CSC ? Les scénarios avec des émissions élevées et très élevées nous mènent à dépasser les +2 °C dès 2050 et à +4-5 °C en 2100.
Il faut comprendre que le changement climatique n’est ni linéaire ni réversible. Le dépassement de certains points de basculement peut induire des mécanismes d’emballement du système climatique vers une trajectoire dite de « terre chaude » qui persisterait plusieurs millénaires. Celle-ci pourrait entrainer, dans plusieurs régions des sécheresses extrêmes et des pics de température dépassant les capacités de thermorégulation humaine.
Ainsi, dans les 50 prochaines années, un tiers de la population mondiale pourrait connaître une température annuelle moyenne > 29 °C, ce qui entrainerait la migration forcée de plus de 3 milliards d’individus. Des modèles mettent aussi en garde contre un possible effondrement de la circulation océanique profonde suite au réchauffement des océans avec pour effet un refroidissement de l’Europe pouvant réduire drastiquement sa production agricole.
Ces scénarios catastrophes risquent d’induire une augmentation des conflits entre pays, mais également au sein même des sociétés, ce qui rendra peu probable la coopération internationale ou le déploiement d’innovations techniques complexes.
Il est tentant d’attribuer à Al-Jaber la responsabilité de cette stratégie techno-optimiste déconnectée de la réalité et risquant de nous mener à la catastrophe. Sa qualité de dirigeant de l’Abu Dhabi National Oil Company alimente déjà les soupçons de conflit d’intérêts. Toutefois, on ne peut attribuer ce nouvel échec collectif d’une COP à une simple erreur de casting. Tout comme on ne peut attribuer l’inadéquation des Contributions déterminées au niveau national de l’accord de Paris aux seuls décideurs politiques actuellement en fonction.
Nous devons reconnaitre que l’incapacité à lutter efficacement contre le changement climatique prend sa source dans les principes mêmes de la gouvernance actuelle, qui s’avère incapable de privilégier le bien commun et d’intégrer le consensus scientifique.
La piste d’une agence internationale indépendante
Il y a urgence. La légitimité des gouvernements repose sur le respect des procédures légales mais aussi, et surtout, sur leur capacité à protéger les citoyens. Quand cette condition ne sera plus remplie, les gouvernements perdront leur légitimité ce qui rendra impossible toute action collective d’envergure.
Nous préconisons une stratégie mêlant sobriété, solutions technologiques, et une gouvernance volontariste et profondément repensée. Une agence climatique internationale indépendante, aux pouvoirs contraignants sur les États, serait mieux à même d’intégrer les consensus scientifiques, de planifier la transition écologique et énergétique et de gérer les biens communs de l’Humanité, en évitant soigneusement les conflits d’intérêts et tentatives de capture économique ou idéologique, qu’elles proviennent d’États, d’entreprises ou d’organisations non gouvernementales (ONG).![]()
Eric Muraille, Biologiste, Immunologiste. Directeur de recherches au FNRS, Université Libre de Bruxelles (ULB); Julien Pillot, Enseignant-Chercheur en Economie (Inseec) / Pr. associé (U. Paris Saclay) / Chercheur associé (CNRS), INSEEC Grande École et Philippe Naccache, Professeur Associé, INSEEC Grande École
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.